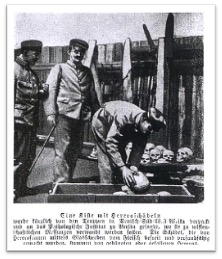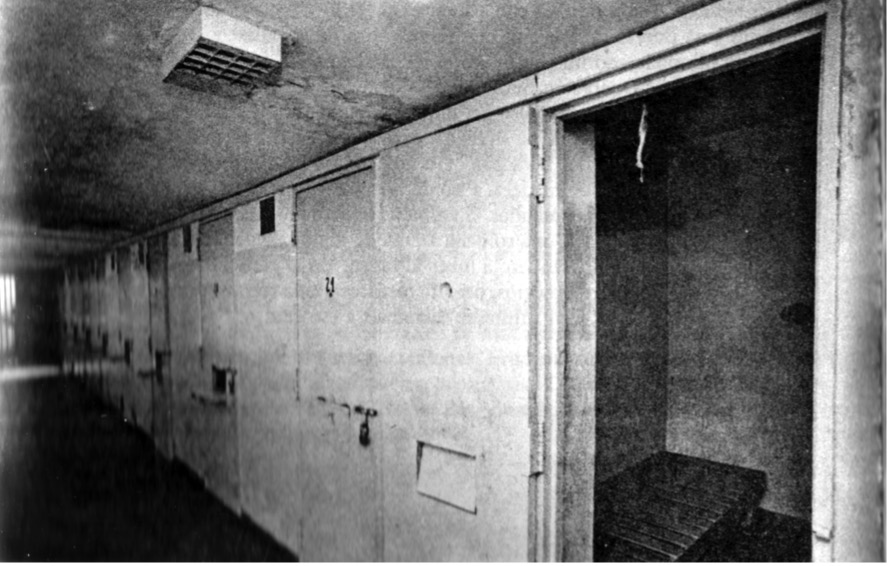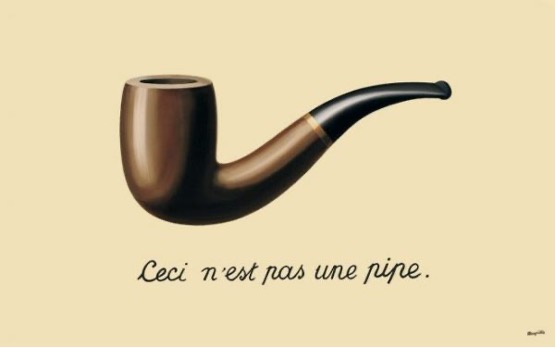Marie-Claire Caloz-Tschopp
Avant-Propos
L’« extrême violence » imprévisible est devenue une aporie dès lors qu’elle met en cause la possibilité de la politique et de la philosophie écrit Balibar. Pour pouvoir se transformer en énigme, elle implique un pari tragique. Dans ce deuxième article[2] consacré à l’ouvrage de Balibar, Violence et civilité (2010), je me propose de cerner sa position, son cheminement philosophique entre violence et civilité. Il s’inscrit dans une ontologie[3] et une dialectique matérielle, social-historique et politique relationnelle – non d’essence – n’éludant pas le conflit vital quand celui-ci atteint des limites extrêmes. Pour lui, le seuil est atteint quand la possibilité de la politique et de la philosophie n’est plus possible. Il a formulé la question en ces termes: comment penser aux extrêmes ?[4]
Sans pouvoir « s’en sortir » de la violence[5], existe-t-il une possibilité d’investigation philosophique ne cédant ni à la métaphysique, ni à l’idéalisme, ni à la théologie, pour penser l’extrême violence dont la guerre moderne[6], les génocides[7], les politiques de disparitions sont autant de marques. Alors lui opposer, non pas une non-violence ou une contre-violence, mais une antiviolence[8] et assurer ainsi de fragiles possibilités pour la politique et la philosophie? L’enjeu est un pari tragique. C’est le pari irréductible de l’altérité contre celui de la tentation de l’absolu, abîme où l’extrême violence nous attire. Changement de lieu d’interrogation, de paradigme : on passe alors de la métaphysique déterministe du limité/illimité à laquelle succèderait une philosophie, une politique du possible/impossible à la portée d’humains connaissant leur part d’inhumain (de violence) dans la part incertaine de l’action. Comme on va le voir, quand le rapport de violence glisse à l’extrême violence, nous dit Balibar, il ne peut s’appuyer que sur le passage par l’autre (y compris de l’altérité en soi).
Introduction
D’emblée, prenons en compte l’avertissement de P. Macherey (2010) dans sa présentation de Violence et civilité : l’association de deux notions nous invite à les confronter. Le terme et, c’est-à-dire leur rapport (de nouage et de disruption ; question et réponse-solution[9]) est important. Macherey pose deux questions : « qu’est-ce qui conduit à considérer que la violence est la question politique par excellence ? En quoi, la question de la politique étant ainsi posée, la civilité constitue-t-elle pour celle-ci une réponse acceptable ? ». Pour ma part, je postule que la première question n’est pas (plus ?) une question politique pour Balibar, mais un problème philosophico-politique. Précisons d’emblée qu’il ne se propose pas de résoudre la question épineuse de classifier des violences, essentielle pour le droit pénal et de la guerre. Son propos, son but sont d’un autre ordre. Après une longue démarche toujours en cours, il cerne une aporie qui prend une place centrale dans sa philosophie politique (Caloz-Tschopp, 2015a). Il devient dès lors évident que pour lui « la politique définit son domaine, ses modalités d’intervention à partir de la confrontation qu’elle entretient avec la violence » (Macherey 2010). Pour Balibar, tout se joue autour d’une reformulation « post-hégélienne »[10] et « post-marxiste » du problème de la convertibilité de la violence extrême en civilité en ne se contentant pas de la non-violence, sans recours à la contre-violence incontrôlable. Balibar explore les limites, les apories de la convertibilité, en écartant les réponses théologiques classiques[11] (mal) et aussi celle de Kant (mal radical), métaphysiques (dialectique fini-infini). Le défi est de penser le rapport entre violence ultra-objective (capitalisme actuel) et ultra-subjective (la subjectivation inscrite dans les catégories identitaires et guerrières ami-ennemi de Carl Schmitt). En quoi consiste alors son pari tragique de la civilité qui évoque un écrivain spécialiste de la question des rapports entre peuples et diasporas (Marientras 2000)?
Autour de l’aporie – le rapport entre violence et politique, violence extrême et politique -, irréductible par la dialectique hégélo-marxiste, l’enjeu pour Balibar est en effet de pouvoir penser les formes de violence d’aujourd’hui, pour nous pousser à réfléchir à la dialectique de convertibilité de la violence extrême en civilité d’antiviolence. Quelles frontières politiques, philosophiques explore-t-il? Comment comprendre le mot extrême utilisé par Balibar pour qualifier la violence? La réponse, on va le voir, ne se trouve pas dans une quelconque essence en dernière instance axiologique théologique (bien-mal), ni dans la liste des synonymes et nuances des qualificatifs (langage). Elle ne se trouve pas non plus dans une liste de critères rationalisables par la logique (degré d’intensité, limites, intention et réflexion, etc.). Retenons que Balibar utilise l’expression « violence extrême » en y ajoutant parfois le mot cruauté qui évoque la frontière entre humain et inhumain, inscrivant ainsi la question dans l’anthropologie politique. Faisons un pas de plus. Tenter de penser l’extrême à l’étape de la globalisation capitaliste d’aujourd’hui exige de cerner l’aporie entre la guerre et la politique, les transformations de la guerre, de la violence, de la politique et, dans une dialectique renouvelée que l’on pourrait appeler une dialectique de la négation empruntée à Hegel et débouchant sur une ouverture incertaine, sans en finir avec la violence, sans « s’en sortir », parier qu’il est possible de transformer un contexte politique dans lequel la violence, fut-elle extrême, n’est plus possible en actions de civilité d’antiviolence continuellement mises en acte. Postulons que sa posture n’est pas un simple clivage entre les domaines de la philosophie et de la morale. Elle est au contraire une construction d’une totalité ouverte à la dialectique possible-impossible.
Au moment de la sortie du livre Violence et Civilité (2010), Balibar précise que dans ses essais de philosophie politique[12], il a abordé au moins quatre fois la notion de violence extrême entre 1996 et 2010, la quatrième intervenant « après-coup » dans la réflexion éthico-politique en 2003 à Paris sur les limites de l’anthropologie politique (Balibar 2010 : 383-417). La démarche du philosophe n’est pas facile à saisir pour de multiples raisons (son ampleur, sa richesse, ses références, les divers contextes, les interlocuteurs, les interventions dans des conjonctures changeantes et sa prudence quand il refuse d’être catalogué, enfermé dans une position qui réduirait la complexité de sa démarche ou alors quand il résiste à se laisser emprisonner dans des rapports de violence entre intellectuels)[13]. Dans un contexte philosophique et politique où la violence fait partie de la politique (violence révolutionnaire inéluctable) et de la philosophie (autoritarisme dans ses multiples formes, notions d’avant-garde, de maître, d’élite, sexisme, etc.) sans qu’elle soit interrogée, Balibar se déplace pour prendre en considération ce qu’elle implique dans la définition même du pouvoir, du communisme, de la révolution, du travail politique, du travail philosophique.
En particulier, il parle de ce qu’il appelle extrême violence dans Violence et Civilité. « C’est par définition une notion malaisée voire paradoxale. Elle indique un seuil ou une limite repérable dans les choses mêmes, mais dans le même temps elle se dérobe aux critères absolus et aux estimations quantitatives. Il y a de l’extrême violence dans les phénomènes de masse qui enveloppent des exterminations ou des génocides, des réductions en esclavage, des déplacements de population, des paupérisations massives assorties de vulnérabilité aux « catastrophes naturelles », de famines, d’épidémie (à propos desquelles on parle précisément de seuils de survie). Mais il y a aussi de l’extrême violence dans l’administration de souffrances physiques ou morales qui sont strictement individuelles, de blessures infligées à l’intégrité corporelle ou au respect de soi-même, c’est-à-dire à la possibilité de défendre et d’assurer sa propre vie « digne ». Et, en un sens, la référence à l’individu singulier ne peut pas plus être éludée que la référence à des situations génériques, sociales, parce que la vie qui porte l’expérience des activités humaines (le langage, le travail, la sexualité, la génération, l’éducation), de même que la vie qui porte des droits dit « de l’homme » ou « du citoyen », est en dernière analyse une vie individuelle, ou plutôt individualisable (ce qui ne veut pas dire isolable, et peut-être même » (Balibar 2010 : 388)[14].
Le parcours autour de l’extrême évoquant L’âge des extrêmes (Hobsbawm 1994) ne se limite pas à la formule, Politics as War, War as Politics, qui, traduite dans la langue d’un empire en guerre, paraphrase la fameuse phrase de Clausewitz en euphémisant le problème que pose le Général. Balibar explique des difficultés théoriques liées à l’emprise de la guerre sur la politique où la tradition philosophique, la pensée, ses outils trouvent leurs limites devant une violence extrême, illimitée, sans fin[15]. Dans les articles de la deuxième partie du livre, il travaille deux exemples : l’aporie de Clausewitz et l’ambiguïté de la théorie marxiste manifestée par la catégorie de Gewalt telle qu’elle est en usage dans cette théorie, en imaginant ensuite la rencontre entre Lénine et Gandhi et les rapports entre Karl Marx et Rosa Luxemburg. Les deux rencontres n’ont pas eu lieu. La réflexion d’anthropologie politique de Balibar formulée « après coup » lui permet de sortir du commentaire de faits, de textes et d’hypothèses et partager un cheminement de recherche d’où émerge ce qu’il entend parle rapport entre violence et civilité.
Le rapport entre violence, guerre et politique est l’aporie centrale de la politique et de la philosophie en Europe et cela depuis longtemps (guerre de Cent ans entre la France et l’Angleterre (1340-1453), guerre de Trente ans en Europe entre 1618 et 1648), avec un degré de gravité qui a émergé dès le XVIIIe siècle avec les guerres napoléoniennes entre 1799 et 1815 et a explosé comme tragédie générale au XXe siècle. Les guerres mondiales, les camps de prisonniers, les camps d’extermination, les bombardements nucléaires de deux villes du Japon sont bien loin de résumer le réel[16]. Ils pourraient être soumis à une réflexion philosophique pratique en travaillant, par exemple, comme le fait Jean-Pierre Faye, sur le terme Vernichtung (anéantissement) dont les camps d’extermination ont été la traduction historique, matérielle, ce que Balibar ne fait pas. Ils ont représenté une rupture diversement vécue dans l’histoire. « Comme nous tous, j’ai pris conscience, progressivement, que la conjonction de la politique et de la violence n’est pas un cas particulier de notre expérience historique, mais qu’elle est toujours indissociable de ses formes et de ses tendances, bien que selon des modalités distinctes et à des degrés inégaux », a déclaré Balibar à Istanbul en mai 2014. Toutefois, d’une part, la prise de conscience n’est pas celle de « nous tous ». D’autre part, comment comprendre le passage des « modalités distinctes » et des « degrés inégaux » de la violence à la violence extrême et à la cruauté, qui est un « reste de violence inconvertible », intrinsèque en tant que part excessive, irrationnelle, destructrice et autodestructrice, inassimilable à la logique des moyens et des fins et « en dehors de toute trace d’altérité », ce qui rend impossible que des sujets soient acteurs politiques d’émancipation, de transformation de la politique ? (Sauvêtre&Lavergne 2010). On se trouve devant une dialectique de la construction/destruction et la problématique du franchissement des « seuils », sans extériorité possible indispensable au rapport, où sont engagées les démarches épistémologiques et d’éthique politique, précise-t-il.
Le rapport étant un non rapport devient aporétique et tragique. Ce n’est pas un simple cas particulier de l’expérience historique de longue durée des humains. Depuis le XXe siècle, il prend des formes intensives, extensives, inédites. Nous n’avons pas de concept non ambigu pour le nommer. Après Benjamin, Arendt, Derrida, en se saisissant de la notion allemande de Gewalt, Balibar montre qu’il est traduit selon les circonstances par violence, pouvoir, force, ce qui dénote une ambiguïté. Pour Héritier (1996 ; 7), ce mot « traite d’une théorisation du pouvoir », exigeant un déplacement radical. La question du rapport devenant un non rapport pointe une aporie à propos du pouvoir sans parvenir à la dénouer dans le paradigme dominant où le lien entre politique et guerre est la représentation du réel accepté et subi comme une fatalité. On a vu que dans sa prise en charge, sa démarche à la fois philosophique (vérité) et politique (justice), Balibar s’épargne l’illusion de dénier la violence extrême, d’y échapper ou alors de la banaliser en lui donnant un statut de moyen politique utile et contrôlable (position utilitariste). Dès lors que l’aporie est prise au sérieux, il en résulte une double transformation dans la pratique philosophique et révolutionnaire que Balibar se propose de révolutionner, comme il se propose de révolutionner l’Etat. Pour saisir ce que ce projet recouvre en terme de civilité, arrêtons-nous au rapport entre la violence extrême et la pratique d’antiviolence qui, pour Balibar, n’est pas réductible à la non violence ou à la contre-violence. Notons que le mot « anti » (contre) exprime dans sa racine grecque, un double mouvement : l’opposition et la protection. On remarque aussi le décalage par rapport à la « contre-violence ». Balibar tente de montrer autre chose. Il ouvre une voie d’évaluation, de mémoire réflexive sur les échecs tragiques de la révolution, la banalisation de la guerre, qui l’amène à une antiviolence non réductible à la citoyenneté institutionnelle mais à une conjugaison entre citoyenneté et civilité, cette dernière étant un élargissement de l’action politique.
L’observation, la description conjointe d’un problème et de la démarche du philosophe, ont permis de mettre en exergue un questionnement sur l’exigence de révolutionner la révolution et de révolutionner la philosophie (Caloz-Tschopp 2015a). Avec des conséquences pour la vérité, la justice, le travail des philosophes, la passion des révolutionnaires habités par les fantômes du passé récent. Qu’est-ce que la dialectique entre violence et civilité, entre la violence extrême et l’antiviolence nous apprend sur les transformations de la politique et de la guerre aujourd’hui et sur l’outil de la dialectique? Comment penser le rapport entre la politique et la guerre, dans l’ordre de l’impensable, de l’indépassable en ce début de XXIe siècle ? Une sorte d’impuissance de la pensée, du savoir, de l’action a lieu devant la violence extrême alors qu’elle semble devenir incompressible, incontrôlable, inconvertible. Autre visage de l’ambiguïté : le rapport entre violence et politique souligne le fait que « la violence est fondamentalement masquée et déniée » (Sauvêtre&Lavergne 2010). Comment, à partir de là, Balibar imagine-t-il pouvoir sauvegarder la possibilité de la politique et de la philosophie, pour pouvoir convertir la violence en civilité ? On sait qu’il emprunte la notion de convertibilité à Hegel, tout en ouvrant des voies de recherche pour une dialectique post-hégélienne ? Que fait-il du reste, de ce qui déborde de la dialectique après Hegel et Marx, à savoir la part du déchet, du jetable (Ogilvie 2012)[17], de la logique de l’anéantissement de la violence extrême, de la politique guerrière « totale » ? Comment la voir, la nommer, la penser? La décrire ? Quels schèmes ? Quels concepts ? Quelle dialectique ? Quelles pratiques ? Où sont les difficultés, voire les labyrinthes de son projet pour ruser avec la violence, « s’en sortir » écrit-il, tout en ne sortant pas de la violence extrême sur la planète? Quels horizons, questions pour la recherche indiquent-elles ?
« Après coup ». Sur les limites de l’anthropologie politique et l’ouverture de la dialectique au tragique
Je ne reprends pas ici le travail de Balibar sur Hobbes et Hegel, autour de la conversion de la violence, ni son essai de topique, ni son développement sur les stratégies de civilité qui composent la première partie du livre Violence et Civilité. Hobbes et Hegel ont fait basculer la politique dans l’histoire et l’immanence. Balibar retient des deux auteurs et surtout de Hegel qu’il est vain de vouloir en finir avec la violence, que le défi est de la convertir, mais il pratique une dialectique post-hégélienne pour que les apories deviennent des contradictions toujours ouvertes, en devenir. La violence souveraine, la contre-violence laissent subsister un résidu irréductible de violence avec son retour du refoulé, qui constitue une zone d’ombre pour la philosophie politique contemporaine. La rationalité du pouvoir ne peut contenir la violence. Par ailleurs, pour se maintenir, le pouvoir a toujours besoin, non seulement de la menace (Hobbes), de l’illusion d’une violence qui trouve son but positif dans le progrès de l’histoire (Hegel), mais d’un supplément de violence, une « part maudite » (Bataille 1949). Par ailleurs, l’Etat de droit souverain, est défini par son contraire, le non droit. L’Etat, ses dispositifs, ses outils échappent à la maîtrise, au contrôle. L’Etat est censé contenir la violence en la monopolisant, mais il la nourrit, la provoque, la développe.
Dans l’histoire moderne capitaliste, l’excès, la démesure, le débordement de la violence tendent à se transformer en violence extrême. On n’assiste pas à une catastrophe « naturelle ». On se trouve sur le terrain matériel de l’exterminisme[18], rapport de pouvoir d’extrême violence impliquant notamment la destruction de la force de travail[19] dans les conditions même de son utilisation. Balibar s’inspire des travaux d’Ogilvie et de son thème de l’homme jetable, traduit en espagnol par poblacion chatarra (population poubelle). Ogilvie travaille cette figure à partir de Hegel et de la notion de populace. Arendt avait parlé « d’humains superflus » (1972). Elle avait centré son attention sur l’impossibilité d’appartenance politique des populations sans-Etat (Caloz-Tschopp 2000) amenant à la Human superfluity, à l’expulsion de la politique, à l’acosmie, voire à l’extermination des sans-Etat au XXe siècle (Juifs, tsiganes, minorités, génocide arménien, etc.). Elle avait souligné le paradoxe d’une exigence d’appartenance politique et d’une expulsion radicale des humains. Dans le nouveau rapport capital-travail, à l’étape du capitalisme globalisé et ses effets chaotiques multiples, l’homme jetable n’est plus (seulement) un exploité ou un surexploité, il est également désaffilié (Castells 2003), exclu de toute appartenance politique, expulsé de la société, des liens sociaux, du monde commun. L’homme jetable n’est plus un prolétaire, c’est un déchet qui n’a plus de place, de statut nulle part. C’est un sans (famille, travail, logement, éducation, culture, santé, statut, citoyenneté, Etat, etc.). Il vit son statut de jetable à la fois dans son corps éclaté et dans sa tête (possibilité de se représenter, de penser sa situation, de vivre bien dans son corps). La violence extrême implique que la société qui l’a produit, l’assigne à ses bords chaotiques, inorganisés, non transformables (banlieues, frontières, camps, prisons, hôpitaux psychiatriques, bunkers) « Car l’extrême violence en tant que rapport de force allant jusqu’au non-rapport de force, qui détruit la nécessaire mise en rapport que suppose tout conflit, anéantit la possibilité même du champ conflictuel ou stratégique », souligne Balibar (Sauvêtre&Lavergne 2010).
En m’intéressant aux multiples points de passage dans la dynamique entre violence et violence extrême et à ses formes actuelles dont l’homme jetable est un des exemples, je choisis de m’arrêter au dernier texte du livre, Après coup. Sur les limites de l’anthropologie politique, (2010 : 385-417). Il n’est pas adressé à un auditoire de théoriciens, de militants, à toute personne intéressée par « l’humain comme exigence : situations et universalité en 2003 »[20], par des questions d’éthique politique et de dialectique ouverte intégrant la dimension fantasmatique, la fiction, le récit pour renouveler la description, c’est-à-dire la dialectique de la raison, ce qui la dépasse et là où elle se réinvente en se pratiquant. Après une première publication en 2003, ce texte a été remanié par Balibar pour sa nouvelle publication dans son livre Violence et Civilité en 2010.Il intervient « après coup », à la fin du volume en formulant des bases pour une « phénoménologie différentielle » des ambivalences et des ambiguïtés de la violence extrême. Il s’interroge sur les limites de l’anthropologie politique pour trouver une ouverture à la nouvelle finitude humaine, à la condition tragique de la politique et de la philosophie.
A partir de la question de la violence extrême, on peut lire ce texte avec en arrière-fond les apories des deux textes précédents édités dans le même livre (2010 : 201-305) en nous demandant quel fil rouge soutient l’ensemble dans le rapport entre violence et politique dont Macherey a souligné l’importance. La juxtaposition de ces textes, permet à Balibar de continuer à « travailler des formulations de manière à en manifester l’ouverture » (13). La double aporie du rapport entre violence, violence extrême et politique, de la « civilisation de la révolution » et de la « civilisation de l’Etat » est interrogée cette fois-ci « après-coup » à partir de la reformulation de la question des limites, de l’illimité. En fait Balibar travaille encore et toujours le rapport entre violence et politique, parle des limites de l’anthropologie et des limites de la dialectique du tragique. En d’autres termes, révolutionner la politique (révolution), révolutionner la philosophie (la pensée, la dialectique), nous oblige à refonder par l’antiviolence à la fois la politique, la civilité et la philosophie, en inventant une nouvelle dialectique post-hégélienne et post-marxienne. Balibar cherche à inventer une nouvelle dialectique post-hégélienne et post-marxienne, une dialectique absolument sui generis, dans laquelle la dynamique conflictuelle n’y a pas de conclusion, pas de convertibilité définitive. Où l’incertitude est la règle scientifique, philosophique, politique. Une dialectique qui n’a pas encore de nom. Le défi est immense. Il est à la dimension du monde d’aujourd’hui.
Depuis l’avènement de la modernité capitaliste, dans le rapport entre violence et politique, l’énigme est devenue la transformation de la violence en violence extrême, un fait politique à intégrer dans l’analyse du problème convertibilité/inconvertibilité par la civilité de la violence en antiviolence. Le défi est la possibilité non tant de la dénier (non violence), d’être « contre » (contre-violence), que de la retourner, de la convertir en citoyenneté/civilité[21] dans une politique qu’il appelle « d’anti-violence ». En bref, la combinaison des deux concepts articule un travail sur les institutions, le droit, l’Etat, la société, les luttes. On peut penser – c’est mon hypothèse pour lire l’œuvre de Balibar – que la question de la convertibilité/inconvertibilité de la violence extrême en civilité de l’antiviolence est devenue la question politique et philosophique qui hante son existence marquée dès sa naissance par la deuxième guerre mondiale, le court XXe siècle, selon la formule de l’écrivain Hobsbaum, le siècle des révolutions et des guerres totales. Balibar constate le paradoxe du marxisme qui a permis de comprendre que la violence et la guerre sont structurelles au capitalisme, à l’impérialisme, tout en étant incapable de fournir des outils pour penser le lien tragique entre violence et révolution, par un processus de réflexivité sur l’histoire et l’action révolutionnaire s’inscrivant dans le projet : révolutionner la révolution, révolutionner l’Etat, civiliser la société.
Comprendre ce que Balibar appelle la violence extrême c’est alors se soumettre à une épreuve qui fait intimement partie de la politique et de la philosophie, toutes deux tragiques aujourd’hui. Passé. Présent. Avenir. Nouvelle philosophie de l’histoire construisant infiniment des totalités provisoires. Loin du présentisme[22], élaborer une politique d’antiviolence, une politique du tragique selon Balibar, implique d’avoir les pieds à la fois dans l’histoire de longue durée, les XVIIIe-XXe siècles, et dans le XXIe siècle.
Etrange texte « après-coup » qui intervient deux ans après le 11 septembre 2001. Il a été écrit entre l’article consacré à Clausewitz et celui sur Gewalt. Même s’il clôture le livre, il fait partie du processus signifiant la distance nécessaire du temps de la réflexion. Ouvrant l’horizon, il invite à un déplacement, à un travail critique sur les limites, la refondation de l’anthropologie politique. En clair, les questions posées parviennent à être formulées sous forme d’enjeux à côté de commentaires de textes et d’hypothèses très élaborées dans le reste du livre. Le voyage de « l’après coup » transforme les apories en questions tragiques ouvertes devant lesquelles Balibar parvient à nous installer. Arendt écrivait à propos de la compréhension qu’elle commence à la naissance et se termine à la mort, qu’elle requiert un travail exigeant sur les résistances à penser l’anéantissement que nous avons devant les yeux (Caloz-Tschopp 2000). Au niveau de la méthode, dans les deux premières parties du texte final, Balibar opte pour une approche phénoménologique différentielle de la violence extrême basée sur des récits, des témoignages qu’il met en rapport avec des textes des sciences sociales, notamment l’histoire (Mbembe) et des textes philosophiques (Spinoza, Arendt, Weil, Deleuze, Agamben). Dans la troisième partie qui traite de la civilité et de l’antiviolence, il ne s’appuie pas sur une phénoménologie de la civilité d’aujourd’hui illustrée par des faits, mais effectue un travail conceptuel, basé pour l’essentiel sur « l’égaliberté » (Balibar 2010) et le « droit d’avoir des droits » (Arendt 1972) qu’il emprunte à Arendt en situant des difficultés qui montrent les limites de l’anthropologie politique. Ce choix pose un problème central dont il faut tenir compte pour pouvoir articuler la violence extrême avec la citoyenneté/civilité[23] : la violence extrême, illimitée, met en cause la possibilité de la politique et de la philosophie. Elle pose un défi tragique à la connaissance et à l’action humaine. Elle n’est pas de l’ordre des catastrophes naturelles, des dérives de la nature humaine, du mal absolu ou bien d’un châtiment divin. La violence extrême est une accumulation de faits matériels et immanents produits par des humains dans un monde de moins en moins prédictible échappant aux outils théoriques dont nous disposons.
De nombreux auteurs (dont Arendt) ont montré, en effet, que le pouvoir total échappe au savoir de la tradition, à notre pensée, à nos catégories, à nos démarches habituelles qui ont tendance à réduire des faits inédits à du connu par l’usage de catégories disponibles par la tradition et le conformisme intellectuel. Comment accepter de voir la violence extrême, la décrire, l’interpréter, sans la fuir, l’exclure alors qu’elle nous terrifie par son imprévisibilité, nous pousse dans des mécanismes de déni de sa gravité, fige l’imagination, la pensée, la parole, le jugement. Nous sommes pris dans l’illusion d’une autoprotection par dénégation, éloignement, et mettons en place toutes sortes de résistances (au sens de Freud) qui banalisent l’objet alors que celui-ci nous échappe. Il est pourtant essentiel de le connaître, de le comprendre, de l’affronter. Il en va de notre survie. Balibar s’attelle à cette tâche à son tour. Il commence par rechercher une unité problématique en parcourant des faits choisis pour constituer une phénoménologie différentielle de l’extrême violence en déconstruisant des catégories négatives de l’anthropologie, de la politique, de l’éthique (le mal, la violence, la mort), en effectuant un inventaire des dilemmes tragiques tout en posant le fait que l’existence de la violence extrême n’implique pas de renoncer à « l’insurrection émancipatrice », à la « résistance intérieure, extérieure », à « l’exigence de civilité » (385). Retraçons le parcours de Balibar pour repérer des questions pour le débat.
Quel est le sens de l’expression violence extrême, se demande-t-il en parcourant les travaux d’Arendt, sur le (post)colonialisme (Mbembe), de Chalamov à Agamben, en passant par Foucault. Il en arrive à problématiser la notion de seuil, de limite, pour considérer la violence extrême dans sa « dynamique propre », comme un des « moteurs » de l’histoire. La limite n’est pas un seuil à ne pas franchir. C’est le moteur du pouvoir capitaliste, sa qualité intrinsèque. En mettant en rapport violence et politique, pour le cerner, il situe la limite dans « une limite du droit et de la possibilité même de la politique qui est la manifestation de la part d’inhumanité » (390).
L’interprétation de l’Iliade par Simone Weil lui fournit une ouverture dans le passage où elle décrit que la force devient inhumaine : l’homme devient une « chose au sens le plus littéral quand elle en fait un cadavre… elle change l’homme en pierre» (390-91). Quand « l’extrémité de la violence anéantit les possibilités de résistance », il n’y a plus de dialectique possible, « la vie apparaît comme pire que la mort » (392). Balibar repère le noeud de la phénoménologie de la violence en poste-colonie à partir du processus d’itération de la violence coloniale de Achille Mbembe dans sa formule « la multiplication de la mort », « d’excès sur la mort » (395), la production de « morts-vivants » (Arendt en parle aussi). Anéantissement, impossibilité de la résistance, réduction à l’impuissance quand existe « la possibilité d’éprouver la vie comme moins supportable de la mort », quand il y a dépossession de sa propre mort. Monde de « désutilité radicale » que les camps ont bien mis en évidence, exercice d’une violence à Guantanamo qui n’est pas fonctionnelle, inscrite dans un rapport moyens-fins, qui ne peut exister « sans ses propres excès, sans montée aux extrêmes ». Les descriptions sur Guantanamo, Abou Graïb, Fallouja, les prisons secrètes, montrent bien la logique des extrêmes qui, par une politique étatique et para-étatique organisée, échappent à tout contrôle institutionnel et politique (Scahill 2014).
Pour Balibar, une des dimensions tragiques de la violence extrême est « la contamination des victimes par la violence » dans la « zone grise » décrite par Primo Levi, où il n’y a plus de distinction entre bourreau et victime, inscrivant l’impossibilité de la résistance, donc d’une réponse à la violence. Il évoque l’exemple des Sonderkommandos évoqué par Primo Levi[24]. Il cite ensuite Bauman (2009), pour cadrer la violence extrême dans l’histoire : l’extermination est « l’accomplissement de la modernité » (398).
Il formule alors une première question liée aux limites de la violence extrême : quand un retournement de la violence extrême s’avère impossible, les limites de la politique sont-elles atteintes ? La question est « cruciale pour la possibilité même de la politique » (399), la résistance, l’antiviolence, la civilité, écrit-il. Face à la violence extrême, on ne se trouve pas à une frontière (Balibar, 1997) mais devant un mur : « le propre de l’extrême violence est justement de tendre à l’anéantissement de cette possibilité, c’est-à-dire à la réduction complète des individus et des groupes à l’impuissance, dont font également partie les différentes formes de violence et de la contre-violence suicidaire » (399). « Il est très difficile de savoir à quel niveau du corps et de l’âme, de l’intérieur ou de l’extérieur d’un sujet, d’un collectif (ou plus vraisemblablement dans leur rapport) intervient le seuil d’anéantissement des possibilités de la résistance », écrit-il. La question de la violence extrême est complétée à ce stade par la référence que Balibar fait à la cruauté, qu’il constate dans la guerre d’ex-Yougoslavie, les génocides, la pratique étatique des disparitions (30’000 en Argentine lors de la dictature), la torture légitimée dans les prisons secrètes, Guantanamo, Abou Ghraib, etc..
Violence extrême, incompressibilité, convertibilité
Balibar utilise le mot extrême dans une perspective qui est en même temps logico-épistémologique et éthico-politique. Il s’en explique en se référant à Wittgenstein : « Ce qui est intéressant, difficile, dans la thématique de la violence, ou dans la différence entre violence et extrême violence, entre violence et cruauté, c’est de problématiser les limites comme telles, les différences, les seuils. La violence n’est pas un objet philosophique quelconque, la violence est un problème politique, c’est un problème moral – je ne le conteste pas – mais c’est aussi de façon privilégiée un problème épistémologique, parce que ce qui fait difficulté en permanence, ce qui est à la fois impossible à éluder, à réduire, à réguler une fois pour toutes, à réduire en classifications stables, c’est l’hétérogénéité ou la différence. On ne peut pas se passer d’une distinction entre violence ordinaire et extrême violence, violence excessive ou violence intolérable comme aurait dit Foucault (1976). Mais on ne peut pas dire une fois pour toutes « voilà où passe la différence », on ne peut pas non plus dire avec sécurité que la violence normale est du côté du pouvoir et la violence excessive du côté de son effondrement ou de son impossibilité, puisqu’une proposition de ce genre à l’épreuve même de la réalité quotidienne se renverse immédiatement en son contraire. Rien n’est plus dangereux d’une certaine façon que la réduction de la violence au pouvoir. Mais cela pose aussi la question de savoir qui énonce la différence et de quel lieu » (Sauvètre&Lavergne 2010, paragraphe 21).
Il n’y a donc pas de solution simple, générale, définitive. Ni épistémologique, ni logique, ni politique, ni éthique. Balibar cherche un critère pour sortir de l’impasse qu’il trouve grâce à Deleuze, lecteur de Spinoza. Ce n’est pas un critère normatif, mais ontologico-politique (puissance de l’Etre). Il consiste en un « minimum incompressible que la violence extrême ne peut anéantir ou retourner contre l’effort de vivre et de penser des individus » (Balibar 2010 : 399). Il tient à l’individualité. Arendt, quant à elle, dans la description du système totalitaire d’extermination, a mis l’accent sur la « spontanéité humaine », une caractéristique que nous pourrions appeler « ontologique » de la liberté politique qu’elle articule à la pluralité que les nazis ne sont pas parvenus à éradiquer, qui est, pour elle comme pour Spinoza, incompressible, individuelle et transindividuelle[25]. La capacité de résistance des individus face à la violence extrême tient au fait que leur Etre est constitué par la liberté et la pluralité jusque dans l’extrême violence et la cruauté. Nous l’apprenons en lisant Arendt et Primo Levi, les nombreux témoignages des camps d’extermination et sur la torture. Elle est possible par le fait que leur Etre n’est pas une essence mais qu’il est constitué par la relation qu’ils parviennent à entretenir à eux-mêmes et aux autres dans les situations les plus extrêmes, qui les aide à survivre et à donner un sens à leur extermination. Robert Antelme (1999) le dit très bien aussi. Des études cliniques en psychanalyse latino-américaine de l’extrême violence ont montré les possibilités du psychisme humain de sauvegarder l’altérité dans la pensée dans des situations extrêmes qui permet de survivre (Amati-Sas 2005 ; Vignar 1989 ; Puget 1989).
Le fait que le système de cruauté vise toujours à pousser plus loin les limites, indique que celle-ci « pose un problème anthropologique et politique fondamental » (401), souligne Balibar. Plus loin, il précise que le minimum incompressible,(Spinoza) permet de soutenir la capacité de résistance à la violence. C’est, souligne-t-il, « en particulier l’idée qu’on ne peut pas empêcher l’homme de penser » (401)[26]. La pensée accompagne donc intrinsèquement l’Etre (Etre et pensée). Elle a un rôle politique quand elle accompagne l’action (comme pour Arendt et Castoriadis[27]), dans l’affrontement à la violence extrême[28]. Ce qui est en jeu est la destruction de la pensée et de l’action par la destruction des relations entre les humains, la transformation des rapports en non rapports (à soi-même, aux autres). La remarque de Balibar est importante, quand on constate les attaques de l’activité de penser, permettant de se représenter le réel de ce qui est – de le penser – étroitement liée aux autres formes de l’agir. Une telle attaque qui est, elle aussi, une des formes de violence extrême, de la guerre, ce que Bertrand Ogilvie montre aussi dans son Essai sur l’exterminisme et la violence extrême (2012).
Ce point est un acquis de la recherche philosophique avec l’exigence de problématiser les présupposés de l’anthropologie politique, écrit Balibar[29]. Il met l’accent non sur la conscience qui sauverait mais sur la relation entre les humains ancrée dans la pensée corporelle, sans approfondir ce que cela suppose dans la mort elle-même au niveau des liens entre individus, dans les liens intergénérationnels soulignés dans les travaux psychanalytiques qui s’occupent de violence et dans les sociétés (récit, mémoire, transmission intergénérationnelle, luttes contre l’amnistie). Pour lui, cette deuxième thèse a l’avantage de « poser le problème éthique au voisinage des limites » (402), question qu’il discute encore avec Badiou autour des figures du bien et de la vérité, puis du bien et du mal, du mal figure du négatif (Kant) dont, écrit-il, il faut trouver une sortie avec Spinoza, pour poser la question « des limites de la capacité politique collective (ou si l’on veut des limites « impolitiques » de la politique) », terme emprunté à Roberto Esposito discutant un ouvrage célèbre de Thomas Mann.
Balibar souligne que la discussion sur la violence extrême n’est plus organisée autour de la question kantienne du mal mais d’une question spécifiquement moderne, celle du rapport entre « la destruction (ou la capture) du politique » et de la « destruction de l’humain » lisible dans les axes d’une double structure de destruction de l’action : modalités « ultra-objectives » (humains transformés en objets dans le monde des marchandises) et « ultra-subjectives » (délire de toute-puissance des communautés et d’individus appelant à la liquidation du mal), qui aboutissent à la transformation des rapports en « non rapports » (Balibar 2010 : 406).
Comment alors « dissocier une pensée de l’histoire et une pensée eschatologique, apocalyptique de la « fin de l’homme » » se demande-t-il ? Il faudrait ajouter de la fin de l’histoire. La question est extrêmement difficile, quand on se trouve face à la coexistence de la production de l’humain par l’homme (société, culture) et « la destruction de l’homme par l’homme dans les formes et les institutions mêmes de l’humanisation » (407). Balibar procède à une discussion de thématiques déjà abordées avec Arendt, Adorno, Derrida à reprendre en détail (407-409), ce que je ne puis faire ici. Empruntons plutôt la voie des limites de la dialectique du tragique.
Le paradoxe, la logique, la dialectique classique ne peuvent décrire au sens du positivisme, le tragique des limites de la violence extrême pour le transformer en pratique politique. Une phénoménologie différentielle réussirait-elle un tel travail de description y compris par la fiction, le récit ? Balibar évoque, à son tour la possibilité d’élargir le travail philosophique par le travail littéraire ce qui permet d’articuler la description dialectique et le récit, le travail de mémoire (ce qu’il n’explicite pas dans ce texte, pas plus qu’il n’explicite sa notion du tragique d’ailleurs).
Balibar retire d’une phénoménologie différentielle des expériences limites d’extrême violence dans l’existence humaine le fait que dans une aporie autour de laquelle on tourne indéfiniment sans pouvoir la réduire, se jouent à chaque fois, sans assurance, les « conditions de possibilité et d’impossibilité » de la politique et de la pensée. Le problème de Hobbes repris par Kant (18) à propos de l’état de nature est toujours présent : « Il faut savoir comment en sortir ». Quand la nouvelle ruse de l’histoire – qui n’est pas un état de nature mais la politique illimitée de destruction atteignant ses limites extrêmes – parvient à nous tenir prisonniers de la violence extrême illimitée, c’est une condition pour qu’elle se reproduise, s’amplifie. En d’autres termes, il faut savoir alors comment s’en sortir sans sortir…
Ne pas en faire une question métaphysique (catastrophe), théologique (mal) mais politique, éthico-politique nous disent Arendt et Balibar. Traduire l’expérience en acceptant l’abîme terrifiant[30], sa complexité, ses apories pour qu’il soit possible inlassablement à la limite de son impossibilité, de convertir la violence extrême et de refonder la politique et la philosophie en ce début de XXIe siècle. Le projet nous fait marcher sur le champ de ruines de l’Ange de Walter Benjamin, pour inventer une « utopie distopique » (Caloz-Tschopp 2011), postuler qu’une citoyenneté/civilité d’antiviolence peut être un nouveau projet politique positif, comme le fait Balibar, à condition de refonder l’anthropologie politique[31].
Les limites de la dialectique et la dialectique ouverte du tragique
Comment dépasser la difficulté à saisir l’objet de la violence extrême pour pouvoir le transformer, sans le laisser échapper par une logique ou une dialectique trop simple ? Balibar souligne à plusieurs reprises que la question du statut anthropologique de l’extrême violence est aporétique. On touche non seulement les limites de l’anthropologie politique mais aussi de la dialectique elle-même, avant de parcourir le labyrinthe de la violence extrême par la politique qui est action incessante de recherche de convertibilité. La tentative d’intelligibilité se heurte à l’aporie. La puissance de la pensée fait partie du minimum incompressible mais l’aporie ne peut être résolue par la pensée, y compris par la raison dialectique. En clair, elle met en cause les possibilités mêmes de la dialectique, en tout cas de la dialectique hégélo-marxiste, voie de recherche que poursuit Balibar. Etrangement, l’auteur n’en retire pas des réflexions sur l’implication d’une telle limite de la pensée pour l’activité philosophique marquée, transformée par la violence extrême, de la même manière que la politique est marquée, mise en danger. Que faire d’une telle impuissance de l’anthropologie politique et de la dialectique ?
En arrivant au bout du parcours de lecture des commentaires et des hypothèses d’un corpus très vaste de textes, on en arrive à se demander si Balibar ne se laisse pas enfermer dans une dialectique interne à des textes et débats philosophiques tortueux. Le travail de pensée en serait-il prisonnier, alors que l’aporie du lien entre guerre et révolution et du nœud de la violence extrême ne peut être dénoué ? Cela amène à devoir articuler, non plus la démarche à l’objet (Caloz-Tschopp 2015a) mais l’objet à l’outil de la pensée de Balibar et ceux-ci à la politique.
Le paradoxe, mot utilisé à plusieurs reprises par Balibar, exprime, dans le travail de penser, l’enfermement, la crise, mode souvent pratiqué par Arendt. On a vu que la guerre absolue qui émerge avec les révolutions des masses échappait aux calculs rationnels de Clausewitz, en mettant en crise la rationalité de la guerre qu’il postulait. La dialectique hégélienne renversée par Marx et pratiquée dans le cadre de la violence du système de production capitaliste, indique les interrogations et la prudence de Marx confronté à la violence du capitalisme et de la révolution à son époque (avec notamment la question de l’organisation qu’il ne tranche pas). La dialectique pratiquée par Engels à propos de la Gewalt aboutit à l’illusion d’enfermer la violence dans le cercle d’une dialectique soumise finalement à la métaphysique du progrès de la révolution face à la violence structurelle du Capital. Quant à Balibar, sa pratique de la dialectique est un essai permanent pour l’ouvrir avec une grande dextérité sur la situation de la violence extrême, tout en déplaçant l’extrême vers les limites, en s’armant d’une puissance ontologico-politique (minimum incompressible) et sur la complexité, l’incertitude devant une situation de « non retour » qu’installe la violence extrême, en posant le fait que l’incertitude de la convertibilité/inconvertibilité d’une politique de la liberté, de l’égaliberté (Balibar 2010), est constitutive du pari tragique d’une politique de la citoyenneté/civilité. Il cherche ainsi à ouvrir une voie pour la liberté, l’émancipation, l’insurrection mise au défi d’intégrer le fait que la politique est devenue tragique après les XIXe et XXe siècles.
Dans un entretien sur la cruauté qui est l’occasion de présenter son livre à un public des sciences sociales (Sauvètre&Lavergne 2010), Balibar explique qu’il existe un point de vue qui répartirait les rôles entre sciences sociales (faits empiriques) et philosophie (éthique, jugements de valeurs). Une phénoménologie de la violence extrême ne peut se satisfaire d’une telle répartition des tâches du savoir, écrit-il. La philosophie et les sciences sociales s’appartiennent mutuellement. Cela permet de lutter contre la métaphysique et le positivisme, de débattre de la dichotomie héritée du positivisme entre jugements de faits et jugements de valeurs avec Wittgenstein, et de construire de nouveaux ponts, à partir de la violence, entre les savoirs articulés à la politique. Dans le paragraphe 17 (Sauvêtre&Lavergne 2010), il apporte une précision importante sur la dialectique : « je continue d’explorer les apories internes à la tradition dialectique, que ce soit celle de Hegel ou de Marx. Cependant, ces apories ne sont pas simplement formelles, elles ne tiennent pas seulement à la méthode dialectique comme telle, mais elles sont spécifiquement liées au rapport que la philosophie entretient avec la politique, donc avec les questions du pouvoir et du contre-pouvoir, ou du pouvoir et de la subversion, de l’insurrection ou de la révolution. Par conséquent elles sont intrinsèquement liées à une réflexion sur la violence. Je suis presque tenté de dire que s’il existe une pensée dialectique qui ne soit ni l’empirisme positiviste ou causal, ni la métaphysique ou la spéculation, c’est précisément dans la mesure où elle revient sans cesse, en tout cas en matière d’histoire et de politique, à la question du statut de la violence, et où elle fait l’expérience de la difficulté, et même à un certain niveau de l’impossibilité, qu’il y a à la circonscrire comme un objet qui soit définitivement donné ». On se souvient de son souci de réflexivité de l’ordre de la philosophie du jugement à réinventer après Kant. C’était aussi le souci d’Arendt qui n’a pu le mener à bien (Amiel 2001, 2011). Il est indispensable à la révolution et au travail philosophique.
La civilité de l’antiviolence en tant que pari politique tragique
Dans la troisième partie de son essai intitulé « après coup », Balibar articule philosophie et politique par le rapport qu’il installe entre violence extrême et civilité d’antiviolence. La politique articulée au travail de réflexivité tranche le nœud gordien de l’extrême violence. Balibar pose d’emblée deux conditions, l’une de méthode philosophique, l’autre politique. Méthode : il faut assumer « l’irréductible complexité qui interdit de rapporter la violence extrême à une seule catégorie » de la raison philosophique. Politique : le voisinage de la violence extrême et de la politique implique de travailler la tension entre citoyenneté et civilité, pour dégager l’enjeu tragique de l’antiviolence.
L’antiviolence n’est pas réductible à la résistance, a-t-il précisé au début du livre. « La notion de résistance est cruciale pour toute pensée moderne » dès lors qu’elle ne signifie pas un simple renversement de pouvoir, mais elle est insuffisante (Balibar 2010 : 23). L’antiviolence envisagée comme possibilité de la politique n’est ni un moyen, ni une fin mais « l’enjeu incertain d’une confrontation avec l’élément d’irréductible altérité qu’elle porte en elle » (Balibar 2010 : 38).
En nous centrant sur le rapport entre violence extrême et civilité, retenons tout d’abord ce qu’il désigne par la notion de civilité : « l’ensemble des stratégies politiques (et des conditions de possibilité de la politique) qui répondent au fait que la violence, sous diverses formes, excède la normalité. » (Balibar 2010 : 101). Je ne reprends pas ici, son analyse de la « Sittlichkeit » de Hegel qui désigne la famille, la société civile et l’Etat. Comme le montre bien Macherey (2010), Balibar cherche à tirer la civilité, du côté d’un deuxième degré de « politicité » accompagnant la citoyenneté, de politique dans ce qu’elle a d’hétérogène, de disparate, de disjonctif, d’inventif, plutôt que du côté de la morale individualiste, ou du côté des doctrines compassionnelles, du care, de la bonne volonté, etc… La civilité n’est pas institutionnelle, elle ne sert pas qu’à reproduire l’institué, elle est instituante. Elle devient un « espacement de la violence », qui l’empêche de s’étendre. « C’est une politique au sein même de la politique » (Balibar 2010 : 163).
Le point de départ est le « présupposé commun » du socle du minimum incompressible emprunté à Spinoza. Citons Balibar qui énonce l’enjeu dans la partie Ouverture du livre : « Au fond, le présupposé commun du « minimum incompressible » spinoziste, de la « politique des droits de l’homme » révolutionnaire, de la lutte pour l’émancipation marxienne, etc. était toujours que la nature humaine minimale dans laquelle le rapport transindividuel (qu’on l’appelle utilité, sympathie, fraternité, communisme, communication ou autrement) est originairement noué à l’affirmation du sujet. Et c’est sur cette base que peut se déployer une pratique politique tendant à la conservation, à la réforme ou à la refondation de l’institution. Mais avec la généralisation d’une situation d’indistinction[32] (ou de « non séparation ») de la production d’institution et de production de violence, une telle représentation devient de plus en plus irréelle. Peut-être cela veut-il dire tout simplement qu’aucune pratique politique n’est plus pensable, qui ne se fixe simultanément comme objectif de faire reculer partout, sous toutes ses formes, la violence subjective-objective qui supprime incessamment la possibilité de la politique. La politique alors ne peut plus être pensée simplement ni comme relève de la violence (dépassement vers la non violence) ni comme transformation de ses conditions déterminées (ce qui peut requérir l’application d’une contre-violence). Elle n’est plus un moyen, un instrument pour autre chose, elle n’est pas non plus une fin en soi. Mais elle est l’enjeu incertain d’une confrontation avec l’élément d’irréductible altérité qu’elle porte en elle. C’est cette autre circularité infinie que, du moins hypothétiquement, j’ai appelé ici « antiviolence » » (38).
Pour reprendre la question de la politique, il faut tenir compte aussi de la tension entre citoyenneté et civilité. La citoyenneté s’inscrit dans les luttes institutionnelles, les rapports avec le système d’Etat. Elle s’institue aux frontières, comme citoyenneté transnationale à travers les frontières. Pour devenir un « lien substantiel », construction immanente collective, réciprocité des droits, elle exige selon le terme de Balibar « l’égaliberté ». La civilité se rattache au « mouvement d’identification et de désidentification ». La construction de la citoyenneté a besoin de la civilité dans la politique « pour y introduire l’espace d’antiviolence, ou d’une résistance à la violence réactive qu’induit la violence elle-même dès lors qu’elle se généralise » (410). L’universalité « négative » dans sa dimension « intensive » (pas territoriale mais égalitaire, démocratique) implique l’instauration d’un « ordre public » dans des conditions « toujours provisoires » et des « limites sociales très étroites ». Ce processus appelé ailleurs « invention démocratique » (Lefort, Castoriadis), revendication de la « part des sans parts » (Rancière), Balibar l’appelle « l’insurrection émancipatrice ». Il recouvre et pérennise la Constitution. Une aporie pratique de la politique se situe dans le travail collectif d’éloignement des formes de « terreur » et de « cruauté » où se réinvente la politique au niveau du sujet et de la société étroitement imbriqués. Il se situe dans la « combinaison paradoxale, pragmatique, performative » qui vise l’autotransformation de la politique.
Balibar revient alors au travail d’Arendt et à son fameux chapitre V de L’impérialisme, le troisième volume des Origine du totalitarisme (1972) où il recèle le « théorème métapolitique » d’Arendt dégagé à partir de la situation historique des « sans-Etat » au XXe siècle où elle dégage le théorème du « droit d’avoir des droits »[33], alors qu’historiquement, toute possibilité de protection par les droits de la part des Etats, a disparu. Qu’il vaut mieux être un chien, un criminel qu’un simple humain ! Arendt n’inscrit pas sa réflexion dans le droit naturel, mais bien dans un droit politique constituant, ouvrant la possibilité d’agir pour constituer l’appartenance politique contre une politique d’extermination, défendre la philosophie au-delà d’une pensée juridico-politique prisonnière des catégories du système d’Etat-nations. Le « droit d’avoir des droits » est un socle constituant qui permet l’action de (re)fondation politique (Caloz-Tschopp 2000). L’action prend aussi les chemins de la compréhension, de la pensée – activités de base de la condition humaine. Agir en constituant le « droit d’avoir des droits », comprendre, penser – qui n’est pas contempler pour Arendt – sont des actions humaines après le désastre. Elles sont liées à la condition humaine de liberté et de pluralité. Par ailleurs, Arendt complète les deux activités non directement politiques[34], dit-elle dans son livre sur la pensée, par le projet d’une philosophie du jugement (Amiel 2001).
Balibar souligne que ce théorème ne prend pas appui dans une autorité divine au-dessus des hommes, ni dans une nature humaine, ni dans un pouvoir autoritaire, mais dans la continuité de la réflexion sur les limites de la violence extrême. Il souligne que son seul fondement est « négatif », « nécessairement et irrémédiablement contingent » basé sur l’appartenance politique qui n’est pas une sécurité absolue pour Arendt (voir le dernier paragraphe du chapitre V de L’impérialisme). Il est « ultra-politique ». Le « droit d’avoir des droits » n’est pas réductible à un « absolu juridique » censé pouvoir empêcher la violence extrême, ni à un « plus jamais ça ». Pas de sauvetage assuré, pas d’assurance absolue dès lors qu’on accepte de vivre l’incertitude (post)-totalitaire souligne Balibar. « C’est en ce sens que je tente de penser une institution de la citoyenneté qui serait en permanence mesurée à l’aune de la civilité, dont l’institution de la civilité constituerait comme la condition intérieure » (414). Là, dans ce qu’on peut appeler un mouvement allant au-delà de la démocratie, de la citoyenneté institutionnelle, se trouve pour Balibar la « dimension tragique » de la politique ne se limitant pas à une « pensée des limites » (phronesis) ou à une « pensée de midi » (Camus). Une politique d’antiviolence de la civilité ne peut donc être une politique de « non-violence » ou de « contre-violence », « qui prévient la violence ou lui résiste » (Balibar 2010, 415). C’est une pratique d’anti-violence civique du « conflit »[35] assumée, travaillée collectivement, qui ne se résume pas à la paix et qui n’a pas de fin, vu que la violence extrême est infinie[36].
Il n’y a pas de « fin de la tragédie » (416). Il n’y a pas de sortie de la scène. Nous sommes mis au défi de « renouveler l’écriture du tragique dans la forme du reportage ou du discours politique » décrivant non des héros (guerriers), mais racontant « ces militants de l’impossible » en Palestine et ailleurs. « Le « tragique » de la politique, c’est l’élément de démesure du pouvoir qu’elle contient » (417). En discussion avec Max Weber autour du texte de ce dernier sur Le savant et la politique, en bref sur la politique et la responsabilité politique du savant il écrit : « le tragique de la politique peut devenir une politique du tragiqueà partir de la décision éthique qui dit que le risque de la perversion de la révolte n’est jamais une raison suffisante pour ne pas se révolter (…) le plus diabolique de la puissance est son impuissance, ou l’illusion de la toute-puissance qui lui est inhérente » (417). Max Weber voulait-il évoquer le tissage entre la politique et l’éthique, se demande Balibar (416), le défi face auquel nous sommes mis de créer une politique du tragique, et évoquer la « perversion de la révolte » inévitable, qui n’implique pas le retrait de la politique ? Contrairement à Hegel, Marientras, spécialiste des diasporas (2014) et de Shakespeare (2000), ne contredirait pas Balibar sur la réinvention d’une politique du tragique. Celles et ceux qui connaissent les « perversions de la révolte », les difficultés de la résistance au jour le jour, de la citoyenneté insurrectionnelle, ne le contrediraient pas non plus.
En arrivant au bout du parcours, on comprend que le plus grand danger guettant l’humain est lui-même et on demande quelle est la spécificité du pari tragique de Balibar par rapport à d’autres traditions du tragique. Balibar ne se réfère certes pas à Aristote, à Nietzsche ou encore aux tragédies de la Renaissance, à Corneille et Racine. La notion du « tragique » qu’il utilise dans Violence et Civilité reste, non théorisée mais elle a une place importante. On pense ici à une autre tradition du tragique dans la pensée politique et philosophique qui est italienne : Machiavel, Vico, Leopardi, Croce, Gramsci[37]. On pense aussi à l’usage des textes littéraires par Balibar. Pour ces auteurs, et pour certains écrivains, la voie tragique est une catharsis du sens commun au sens d’une formation du vivere civile, mais comment, après Max Weber, est-elle dessinée par Balibar pour échapper au funeste, au fatal, au pessimisme radical d’un Nietzsche? Notons que son cadre, ses enjeux, sa vision de l’action sont bien situés. En bref, elle se joue dans la tension extrême entre vie et mort, dans la possibilité/impossibilité de la politique et de la philosophie comme critère de détermination de la violence extrême ; elle intervient dans l’invention d’une pratique de la dialectique du possible/impossible quand elle est confrontée à la violence extrême ultra-objective, ultra-subjective qui constitue la domination et la révolution, et sa traduction dans les changements des pratiques de la citoyenneté/civilité.
En conclusion : du limité/illimité au possible/impossible humain… convertibilité/inconvertibilité de la violence
Le thème de la violence extrême, de la cruauté qui, pour Balibar, conduit aux limites de l’anthropologie politique et appelle à une nouvelle anthropologie politique (tâche que s’assigne Balibar), de la dialectique hégélo-marxiste et à sa réinvention dans une nouvelle articulation du lien, du rapport entre politique et philosophie, est un thème central aujourd’hui pour élaborer d’autres faits historiques qui résistent à la conscience sociale (génocides, guerres « totales », pillages, surexploitation coloniale, impérialiste, etc.) et prendre la mesure des faits actuels d’extrême violence. Le pari est crucial (comment ne pas mobiliser une métaphysique épaisse en convoquant la question anthropologique ? La question dépasse le cadre de notre article mais il en appelle au débat. Balibar nous a-t-il conduit au bout de la première question de Macherey (« qu’est-ce qui conduit à considérer que la violence est la question politique par excellence ?). Toute sa démarche montre l’émergence de la question et l’élaboration d’une nouvelle position, d’une nouvelle dialectique dans le travail philosophico-politique situé dans le cadre d’une anthropologie politique renouvellée. On apprend en le lisant que la ruse n’est pas l’illusion de « s’en sortir » de la violence, mais de la dévier pour l’amener sur le terrain d’un travail incessant, ouvert, incertain, de sa convertibilité/inconvertibilité. C’est une possibilité/impossibilité de tout humain, de toute société.
Le texte de Balibar écrit en 2003, a été actualisé en 2010 a en effet le mérite d’articuler les notions de violence et de civilité pour trouver des voies praticables pour l’anthropologie politique, la dialectique, la pratique philosophique et politique. Les descriptions phénoménologiques des faits d’extrême violence et des pratiques actuelles d’antiviolence sont en cours dans de multiples lieux de la planète. La philosophie, les sciences, la littérature, les sciences sociales, le droit international des peuples, l’histoire, l’économie politique, la philosophie politique, les recherches féministes, les nouvelles luttes des mouvements sociaux, etc. sont autant d’étais empiriques, dont l’hétérogénéité et la synthèse ouverte font partie de l’exploration des limites et des besoins de connaissance actuelle pour tenir compte de la complexité, articuler le cadre politique, l’extrême violence et la citoyenneté/civilité insurrectionnelle, survivante, constituante, créatrice. Sa possible convertibilité en civilité d’antiviolence n’est pas un concept abstrait, mais un mouvement instituant/constituant où la part destructrice et créatrice de l’humain est présente.
L’extrême violence, son renversement toujours provisoire en civilité renvoient aussi au rôle de l’ambiguïté[38], de la plasticité humaine dans son rapport à la limite dans la survie. Dans les situations extrêmes, l’ambiguïté peut être un mécanisme de défense (Amati, 2005) pour survivre, mais l’indice de sa présence n’est pas suffisant. Balibar nous montre que la limite est atteinte quand l’extrême violence, la cruauté rendent possible/impossible la pensée et la citoyenneté/civilité constituante, c’est-à-dire quand on a l’impression qu’un mouvement de convertibilité, de transformation, de changement n’est plus possible. Cette limite, précise-t-il, est encore et toujours repoussée par l’action et par la pensée même en conditions extrêmes dans les guerres, la torture, la répression, les politiques d’extermination, de génocides, de destruction. Et aussi par l’action. Le lieu du rapport entre l’action et la pensée est ce « minimum incompressible » dont parle Spinoza et que lui emprunte Balibar.
C’est la marge d’indétermination, le lieu intermédiaire entre être et non être, c’est le noeud gordien objectif-subjectif d’une refondation tragique incessante, ouverte à la base d’une nouvelle anthropologie politique, d’une dialectique de la pensée et de l’action ouverte, incertaine, inconnaissable. Balibar ne formule pas une utopie s’inscrivant dans la tradition utopique classique liée au progrès de l’histoire (More, Hegel, etc.)[39]. Il cherche un cheminement pour vivre l’incertitude ouverte au pire et au meilleur dans les conditions historique, matérielles existantes et en devenir. Le déplacement d’une métaphysique déterministe du limité/illimité (induisant la soumission, l’obéissance, etc.) vers une anthropologie politique du possible/impossible renouvelée par la prise en compte des frontières de l’humain[40], est pourtant une preuve du pari tragique de la possibilité/impossibilité de la politique et de la philosophie, nous montre Balibar. Devant le vertige de la violence illimitée, la possibilité/impossibilité de l’activité humaine dans l’extrême violence qui est le « moteur » du capitalisme est le lieu mouvant du pari tragique d’une possibilité de survie, de vie, de liberté, d’autonomie dans un espace-temps de fragile création[41] de citoyenneté/civilité.
Les modalités, les complexités changeantes du passage par l’autre pour explorer la dialectique entre violence et civilité, développer une politique « d’anti-violence » est l’énigme ouverte du pari.
Genève, 21 août 2015.
Eléments bibliographiques
Abad Faciolince Hector, El olvido que seremos, Barcelona, Sex Barral, 2005.
Adorno Theodor W., « Was bedeutet : Aufarbeitung der Vergangenheit », in Gesammelte Schriften, to. 10(2), Francfort, Suhrkamp, 1977 (1959).
Agier Michel (dir.), Un monde de camps, Paris, La Découverte, 2014.
Amati-Sas Silvia, L’ambiguïté comme défense dans les traumas extrêmes, Congrès de l’APA, Rio, 2005.
Amiel Anne, « Expérience et conceptualisation (Hannah Arendt). Comment se pensent les révolutions ? Comment les penser ? », in Caloz-Tschopp Marie-Claire (dir.), Penser pour résister. Colère, courage et création politique, Paris, l’Harmattan, 2011, p. 47-63.
° La non-philosophie de Hannah Arendt. Révolution et Jugement, Paris, PUF, 2001.
Antelme Robert, L’Espèce humaine, Paris, Gallimard 1999 (1947).
Arendt Hannah, Les origines du totalitarisme, 3 vol., Paris, Point-essai, 1972 (1951, 1958).
° La vie de l’esprit. 1 la pensée, Paris, PUF, 1981 (1971).
Aron Raymond, Penser la guerre. Clausewitz I. L’âge européen, Paris, Gallimard, 1976.
Bachelard Gaston, La Philosophie du non. Essai d’une philosophie du nouvel esprit scientifique, Paris, PUF, 1988 (1940).
Badié Bertrand & Vidal Dominique, Nouvelles guerres, Paris, La Découverte. Etat du monde, 2014.
Balibar Etienne & Ogilvie Bertrand (dir.), Violence et Politique. Colloque de Cerisy, 1994, Revue Lignes no. 25.
Balibar Etienne, Violence et Civilité, Paris, Galilée, 2010.
° La proposition de l’égaliberté, Paris, PUF, 2010.
° Citoyen sujet et autres essais d’anthropologie philosophique, Paris, PUF, 2011
° « Comment penser aux extrêmes ? Lettre à Bertrand Ogilvie par Etienne Balibar », in Ogilvie Bertrand, L’homme jetable. Essai sur l’exterminisme et la violence extrême, Paris, éd. Amsterdam, 2012, p. 7-25.
° L’Europe, l’Amérique, la guerre. Réflexions sur la médiation européenne, Paris, La Découverte, 2003.
° « Le prolétariat insaisissable », in Balibar E., La crainte des Masses, Paris, Galilée, 1997, p. 221-251.
° « Qu’est-ce qu’une frontière ? », in Balibar E., La crainte des Masses, Paris, Galilée, 1997, p. 371-381.
° « Violence : idéalité et cruauté », in Françoise Héritier, De la violence, Paris, Odile Jacob, 1995, p. 57-87.
° La philosophie de Marx, Paris, La Découverte, 2001 (1993).
° Les frontières de la démocratie, Paris, La Découverte, 1992
° « Le moment philosophique déterminé par la guerre dans la politique : Lénine 1914-1916 », in Soulez Ph. (éd.), Les Philosophes et la guerre de 14, Presses universitaires de Vincennes, 1988, p. 113-125.
° « Etat, parti, idéologie : esquisse d’un problème », In Balibar Etienne, Luporini Cesare, Tosel André, Marx et sa critique de la politique, Paris, Maspéro, 1979, p. 129-234.
Balibar Etienne, Caloz-Tschopp Marie-Claire, Insel Ahmet, Tosel André, Violence, civilité, révolution. Autour d’Etienne Balibar, Paris, la Dispute, 2015.
Bataille Georges, La part maudite, Paris, Minuit, 1949.
Bauman Zygmunt, Modernité et holocauste, Paris, La Fabrique, 2002 (réédition éd. Complexe, 2009).
Bernard Philippe, « Les damnés des « zero hour contracts », Le Monde, 27.10.2014, 12.
Belger José, Symbiose et ambiguïté, Paris, PUF, 1981.
Bonneuil Christophe, Fressoz Jean-Baptiste, L’Evénement anthropocène. La Terre, l’histoire et nous, Paris, Seuil, 2013.
Bozarslan Hamit, « Quand la violence domine tout mais ne tranche rien. Réflexions sur la violence, la cruauté et la cité », Actes du Colloque d’Istanbul (mai 2014). A paraître.
Caloz-Tschopp Marie-Claire, Veloso Bermedo Teresa (dir.), Penser les métamorphoses de la politique, de la violence, de la guerre, avec Colette Guillaumin, Nicole-Claude Mathieu, Poala Tabet, féministes matérialistes, Paris, L’Harmattan 2013.
Caloz-Tschopp Marie-Claire, « Révolutionner la révolution et la philosophie avec Etienne Balibar, (2015a) in Balibar Etienne et al., Violence, civilité, révolution, Paris, La Dispute, 2015.
° Mondialisation, développement, résistance. Du rêve utopique à la praxis d’utopie dystopique. Publié en anglais sous le titre, « Globalization, development, resistance of utopian dreams to the praxis of dystopian utopia », in Bagchi Barnita,The Politics of the Impossible, ed. SAGE (Delhi, London, Thousand Oaks, chap. XII, 2011.
°« Depuis la violence de l’exil, penser la lutte du désexil. Une position, une démarche philosophique pour désexiler l’exil », Revue en ligne Repenser l’exil no. 4, url : http://exil-ciph.com/Revue_numero04/articles/0101MCCT.html, 2015b.
° Les sans-Etat dans la philosophie de Hannah Arendt. Les humains superflus, le droit d’avoir des droits et la citoyenneté, Lausanne, Payot, Lausanne, 2000 (thèse).
Barnabi Elie, Dix thèses sur la guerre, Paris, Flamarion, 2014.
Castel Robert, L’insécurité sociale. Qu’est-ce qu’un être protégé ? Paris, Seuil, 2003.
Castoriadis Cornélius, Les carrefours du labyrinthe, Paris, Seuil, 1978.
Colliot-Thélène Catherine, « Violence et Contrainte », Revue Lignes, no. 25, 1995, p. 264-280.
Dubuis Etienne, « Les théoriciens de l’Etat islamique », Le Temps, 3.09.2014.
Engels, « lettre d’Engels à Marx du 7 janvier 1857 », citée par H. Münkler, 2002, p. 127, note 46.
Fanon Frantz, Les Damnés de la terre, Paris, Maspéro, 1961.
Faye Emmanuel, « Introduction », Fuchs Edith, Ecritures d’auschwitz, Paris, éd. Delga, 2014.
Foucault Michel, Il faut défendre la société, Paris, Seuil/Gallimard, 1976, (voir pages 213-235).
Gonzalez Olga L., « La Colombie ou la violence exacerbée », in Amérique latine : identités et ruptures, dir. Gélard J.-P. Chemin A., Presses Universitaires de Rennes, éd. Complexe 2008., p. 239-298.
Héritier Françoise, De la violence I, séminaire de Françoise Héritier, avec les contributions de Étienne Balibar, etc.., Paris, Odile Jacob, 1996. Exposés présentés dans le cadre du séminaire de F. Héritier au Collège de France, janvier-mars 1995 ; rééd. 2005.
Handman, « Violence et différence de sexe », Revue Lignes, no. 25, 1995, p.205-218.
Jameson Fredric, The Ideologies of Theory Essays (1971-1886), vol. II, Syntax of History, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1988.
Kenzaburo Oé, Adieu, mon livre, Paris, éd. Philippe Picquier, 2013 (2009).
Kervegan Jean-François, « Politique, violence, philosophie », Revue Lignes, no. 25, p. 57-70.
Gothot J., « François Rigaux : la chute des masques », in Nouveaux intinéraires en droit. Hommage à F. Rigaux, éd. Bruylant, Bruxelles, 1993, p. 19-85.
Hobsbawm Eric, L’âge des extrêmes, histoire du court XXe siècle (1914-1990), Paris, Monde diplomatique/éd. Complexe, 2008 (1999).
Lanzmann Claude (dir.), La souveraineté. Horizons et figures de la politique », Les Temps modernes no. 610, 2000 (articles de Balibar, etc.) .
Laurens Henry, Delmas-Marty, Terrorismes. Histoire et droit, Paris, Biblis CNRS, 2010.
Lecour Grandmaison Olivier, Coloniser, exterminer. Sur les guerres de l’Etat colonial, Paris, Fayard, 2005.
Loraux Nicole, La Cité divisée, Paris, Payot, 1997.
Loraux Nicole, Sapir Jacques, Terray Emmanuel, « Formes et frontières de la guerre », Cahiers d’études stratégiques, no. 15, 1991, CIRPES.
Macherey Pierre, Présentation de l’ouvrage d’Etienne Balibar « Violence et Civilité », Internet, version 21 mai 2010, url : http://philolarge.hypotheses.org/513.
Maffesoli Michel, Essais sur la violence, Paris, Biblis, 2009.
Marientras Richard, Shakespeare au XXe siècle, Paris, Payot, 2000.
° Etre un peuple en diaspora, Paris, Prairies ordinaires, 2000 (1975).
Martinez-Gros Gabriel, Brève histoire des Empires. Comment ils surgissent ? Comment ils s’effondrent ? Paris, Seuil, 2014.
Marx Engels Werke, t. 22, Berlin, Dietz Verlag, 1963.
Montagut Muriel, Les possibilités d’être après la torture, Thèse Université Paris-Diderot (mention sociologie clinique), 24 octobre 2012.
Mosse George, De la Grande Guerre au totalitarisme. La brutalisation des sociétés européennes, Paris, Hachette-littérature, 1999.
Mbembe Achille, Critique de la raison nègre, Paris, La Découverte, 2013.
° De la postcolonie. Essai sur l’imagination politique dans l’Afrique contemporaine, Paris, Karthala, 2000.
Münkler Herfried, Ueber den Krieg. Stationen der Kriegsgeschichte im Spiegel ihrer theoritischen Reflexion, Weilerswist, Velbrück Wissenschaft, 2002.
Nettle J.-P., Rosa Luxemburg, Paris, Spartacus, 2012 (chap. IX, XIII).
Ogilvie Bertrand, L’homme jetable. Essai sur l’exterminisme et la violence extrême, Paris, éd. Amsterdam, 2012.
Panajotis Kondylis, Theorie des Krieges, Clausewitz-Marx-Engels-Lenin, Stuttgart, Klett-Cotta, 1988.
Puget Janine (dir.), Violence d’Etat et psychanalyse, Paris, Dunod, 1989.
° Subjetivacion discontinua y psicoanalisis. Incertidumbre y certezas, Buenos Aires, 2015.
Renault E., « L’élargissement du concept de pratique et ses avatars », in Haber S. (éd.), L’action en philosophie contemporaine, Paris, Ellipses, 2003, p. 224-245.
Rivas Manuel, Tout est silence, Paris, Gallimard, 2010.
Rojas Jose Maria, La estrategia del terror en la guerra de conquista 1492-1552, Medellin, Hombre Nuevo éd., 2011
Saint-Amand Pierre, « De l’incivilité », critique du livre de John Keane, Reflections on Violence, Londres, Verso), Critique no. 596-597, 1997, pp. 88-98.
Scahill Jeremy, Dirty War. Le nouvel art de la guerre, Paris, Lux, 2014.
Selek Pinar, Service militaire en Turquie et construction de la classe dominante de sexe dominante. Devenir homme en rampant, Paris, l‘Harmattan, 2014.
Selek Pinar, Parce qu’ils sont arméniens, Paris, Liana Levi, 2014b.
Suter Patrick, Frontières, Berne, Passage d’Encres, 2014.
Terray Emmanuel, Clausewitz, Paris, Fayard, 1999.
Tosel André, « Note sur le colloque autour d’Etienne Balibar, Istanbul mai 2014 », in Actes du colloque à paraître (2015).
° « Bonapartisme. Penser l’histoire entre théorie et récit. Le XVIIIe de Louis Bonaparte de Karl Marx », Revue en ligne, Repenser l’exil no. 4, 2014, url : http://www.exil-ciph.com/Revue_numero04/articles/0601ATosel.html
Uribe de Hincapié Maria Teresa, Lopez Lopera Maria, Las palabras de la guerra. Un estudio sobre las memorias de las guerras civiles en Colombia, Medellin, éd. La Carreta historica.
Vignar Maren et Marcelo, Exil et torture, Paris, Denoël, 1989.
* Cet article, sous le titre « Violence : le pari tragique de l’inconvertibilité/convertibilité » remanié et raccourci a été publie dans Rue Descartes no. 85-86, 2015/2. Sous cette forme, il a été publié dans l’essai, Caloz-Tschopp Marie-Claire, La liberté politique de se mouvoir. Desexil et création : philosophie du droit de fuite, Paris, Kimé, 2019, p. 461-497
[2] Voir Caloz-Tschopp M.C., 2015a, pp. 93-157.
[3] « Terme forgé au XVIIe siècle pour désigner ce qu’Aristote avait appelé la « science des premiers principes et des premières causes » et qu’il identifiait à une réflexion sur « l’être en tant qu’être » (on hè on), distincte de l’étude des genres particuliers », (Balibar 2011: note 12, p. 30).
[4] Sans pouvoir approfondir ici l’influence de Bertrand Ogilvie sur le cheminement d’Etienne Balibar en ce qui concerne son approfondissement de la violence, notons l’importance du débat entre les deux penseurs autour de cette question. Voir notamment à ce propos la préface d’Etienne Balibar à l’essai de Bertrand Ogilvie sur l’homme jetable (2012).
[5] Balibar utilise dans son livre le mot violence et celui, moins souvent, de violence extrême, ou extrême violence. Voir par exemple : Balibar et al., 2015, p. 18.
[6] La bibliographie est énorme à ce sujet, des plusieurs continents, langues, domaines des savoirs. Voir un important travail interdisciplinaire en France, Cabanes Bruno (dir.), Une histoire de la guerre, Paris, Seuil, 2018. Voir aussi, dans un souci de décentration, Mbembe Achille, Politique de l’inimitié, Paris, la Découverte, 2018 (2016) où l’auteur s’intéresse au renversement des démocraties libérales, quand elles ne font plus seulement des guerres impériales, mais endossent les habits de l’exception, en menant alors la guerre contre elles-mêmes et leurs ennemis.
[7] Voir notamment, l’importante synthèse de Semmelin Jacques, Purifier et détruire. Usage politique des massacres et génocides, Paris, Points, 2005. Voir aussi, le court essai de deux enseignants américains, Herman Edward, Peterson David, Génocide et propagande. L’instrumentalisation des massacres, Paris, Futur proche, 2012.
[8] Je remercie Violeta Araujo, exilée, membre du Groupe de Genève, « Violence et droit d’asile en Europe », d’avoir insisté sur cet aspect des travaux d’E. Balibar, tout au long de nos réflexions.
[9] Pierre Macherey (2010) situe la solution dans la civilité permanente, plurielle, ouverte ainsi redéfinie par Balibar. Il écrit en conclusion de son article qui présente le livre Violence et Civilité : « cette solution est, en elle-même, problématique : elle consiste en une permanente reprise en compte des termes du problème qu’elle renonce à éluder, ce que font précisément les tentatives de solution non problématique qui prétendent mettre fin à la question. Il s’agit donc, non de refermer cette question, mais de la laisser ouverte, en vue d’en affronter les aspects multiformes qu’aucune construction politique réglementaire ne parviendra jamais à ramener à une norme commune, impossibilité dont la prise en compte relève du principe de civilité ».
[10] A ce propos, la lettre de Balibar à Ogilvie est très intéressante. Voir Ogilvie, « Comment penser aux extrêmes ? Lettre à Bertrand Ogilvie par Etienne Balibar », in Ogilvie, 2012, pp. 7-25.
[11] Il existe des courants minoritaires en théologie qui ne sont pas basées sur le binôme bien-mal (ex. théologies de la libération, Martin Luther King). Je remercie Yala Kisukidi pour sa remarque.
[12] Les Welleck Lectures à Irvine en Californie.
[13] Dès 1994, à l’occasion d’un colloque sur le thème Violence et Politique à Cerisy, tout en élargissant ses interrogations, notons qu’il questionne la violence des intellectuels (Balibar 1995).
[14] Pour la définition « d’extrême violence » je m’en tiens au livre étudié. Mais on peut trouver des explications de Balibar à ce sujet dans plusieurs textes et interventions. Citons par exemple, sa conférence de Belgrade en 2011 que l’on trouve sur Internet où il synthétise très bien son travail.
[15] L’enquête Dirty War, sur la nouvelle forme de guerre engagée par Bush contre le terrorisme, se termine par la phrase suivante : « Une question douloureuse demeure, pour tous les citoyens des Etats-Unis : comment une telle guerre peut-elle prendre fin ? », (Scahill 2014, p. 624).
[16] Exigence de décentration…Notons que les exemples cités par Balibar sont intraeuropéens et font l’économie d’exemples se référant au colonialisme et à l’impérialisme européen en Afrique (ex. Congo belge, Namibie), en Amérique latine, en Asile. On pense aussi aux travaux sur la Conquista en Amérique latine (Rojas 2011). On pense encore aux travaux féministes sur les « féminicides » entre le Mexique et les Etats-Unis… Je remercie Yala Kisukidi pour sa remarque à ce propos qu’elle fait en pensant aux exemples africains.
[17] Une des figures du marché du travail en Angleterre, nous est donnée par le contrat de travail « zero hour contracts ». Les salariés convoqués ou « annulés » par SMS, disponibles 24 heures sur 24, sans garantie de salaire (Bernard, 2014).
[18] On pense à la fameuse leçon de Michel Foucault (1976), « Faire vivre et laisser mourir » qui est devenue une formule pour qualifier notamment les nouvelles politiques de la santé (Sida, Ebola, faim).
[19] Notons que Balibar ne centre pas son analyse sur le rapport du capitalisme à la nature, ni sur les transformations de la science et de la technique, de la technologie, mais qu’il centre son propos sur le rapport capital-travail.
[20] Organisé par le Laboratoire de philosophie pratique et d’anthropologie les 4-5 décembre 2003 par l’Institut catholique de Paris, Faculté de philosophie.
[21] Un exemple dans le contexte de guerre civile peut être donné pour illustrer en partie le propos. Lors de la guerre du Sonderbund, opposant en Suisse cantons catholiques et cantons protestants au moment de l’émergence de la modernité capitaliste (1847), le Général Dufour, à la tête de l’armée officielle, opte pour une stratégie de négociation. Cette manière de mener la guerre limite sa durée (trois semaines) et le nombre des victimes : morts du côté de l’armée officielle (protestante) et 33 morts parmi les opposants catholiques. Cet exemple suscite souvent une certaine incrédulité. Voir notamment, Divers auteurs, Nouvelles histoire de la Suisse et des suisses, Lausanne, Payot, 1983.
[22] Voir à ce propos, ce que dit l’écrivain japonais Akira Mizubayashi sur le poids de cette notion au Japon, Petit éloge de l’errance, Paris, Folio, 2014.
[23] Pour l’expression « citoyenneté/civilité », voir Violence et Civilité, p. 409 et suivantes.
[24] « Nous le peuple des maîtres, nous sommes vos destructeurs, mais vous n’êtes pas meilleurs que nous ; si nous le voulons, et justement nous le voulons, nous sommes capables de détruire non seulement vos corps mais vos âmes, comme nous avons détruit les nôtres (…). Nous vous avons embrassés, corrompus, attirés tout au fond avec nous » (Balibar 2010 : 397 ; il cite Primo Levi).
[25] Un des aspects du transindividuel est la survivance et la place des témoins et les processus dans la manière d’en parler qui éliminent sa présence. On pense à la captation, au rapt, à l’instrumentalisation de leurs paroles, à la manière de les qualifier. L’exemple le plus frappant est peut-être le rôle majeur attribué au « musulman » dans les camps d’extermination, avancée par Agamben est une interprétation extrêmement réductrice de leur présence, et rend impossible le rôle du témoin, désubjectivisant radicalement un individu humain en situation extrême d’attaque de sa subjectivation, comme l’explique bien Emmanuel Faye (2014).
[26] Formulation qu’il met étrangement entre parenthèse.
[27] Pour Castoriadis, comme pour Arendt, ce qu’il appelle le projet d’autonomie implique l’agir politique accompagné par la pensée (1978, p. 356).
[28] Arendt, dans La vie de l’esprit, explique, que la pensée est une activité qui n’est pas directement politique mais qu’elle le devient dans les situations extrêmes.
[29] La philosophie du contrat contre Hobbes dit qu’il n’y a pas de nature humaine opposable à l’histoire ; le mal est imaginaire et n’est réel que si nous en avons conscience ; « en dernière analyse la mort est le « mal » par excellence parce qu’elle correspond à l’isolement définitif de l’individu en face de ses semblables : on peut donner et recevoir la mort, mais on meurt toujours seul, sinon pour « soi-même », p. 402).
[30] La politique de la terreur est un des traits constitutifs du système totalitaire, a montré H. Arendt dans son livre, Les origines du totalitarisme, Paris, Point-essai, 1972. Voir le système totalitaire, vol. 3. Il a été aussi un trait constitutif de la Conquista (Rojas 2011).
[31] Il développe son projet dans son autre livre de la trilogie, Citoyen-sujet (2011). Par ailleurs la question des rapports entre anthropologie et métaphysique qui est importante dépasse le cadre du livre Violence et Civilité et je ne peux m’étendre dans cet article à développer ce point.
[32] En lisant ce mot, on pense à ce qu’écrit Jose Bleger (1981) sur la symbiose (voir l’avant-propos).
[33] Ce sujet est l’objet de ma thèse publiée en 2000.
[34] Sauf en cas de destruction de tout espace public, quand la violence extrême illimitée a détruit les cadres, les lieux pour la contenir et la convertir.
[35] Arendt n’envisage pas le conflit, contrairement à Castoriadis quand il définit la démocratie en tant qu’incertitude immanente à l’existence humaine et le conflit comme étant constitutif de l’expérience démocratique.
[36] « Le propre de l’extrême violence n’est pas tant, peut-être de détruire la paix ou de la rendre impossible, que d’anéantir le conflit lui-même, en lui imposant une démesure qui le prive de toute histoire et de toute incertitude » (p. 416).
[37] Je remercie André Tosel pour ce rappel.
[38] Voir les Actes du colloque sur l’œuvre de Jose Bleger, Genève 2015. Caloz-Tschopp M.C. (dir.), Ambiguïté, Violence et Civilité. (Re)lire aujourd’hui José Bleger (1923-1972) à Genève, 2014. Voir exil-ciph.com
[39] Voir à ce propos Caloz-Tschopp (2011).
[40] Balibar ne développe sa réflexion explicitement sur la nature. Il se situe dans le domaine de l’anthropologie politique.
[41] Les quelques remarques de Balibar concernant la philosophie de l’histoire ne sont pas reprises ici.