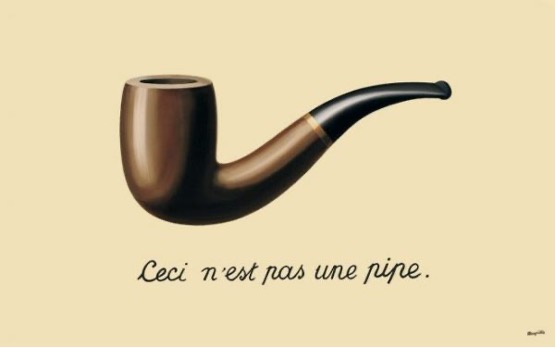Marie-Claire Caloz-Tschopp
Traducción del francés: Marta Huertas
Resumen
Describir la relación entre tortura y migración es examinar sus imprevisibles fundamentos, sus principales desafíos civilizacionales. En la relación entre capitalismo y tortura, y entre tortura y migración, esta reflexión filosófica y política se propone identificar una aporía: ¿qué pasa con la violencia extrema (Balibar) inscrita en la auto-destrucción de la humanidad? La tortura, como un pulpo, extiende sus tentáculos, plantea nuevas incógnitas sobre las luchas, el conocimiento y los derechos humanos. El principal desafío es radicalizar el trabajo crítico, aprender a pensar en los extremos, reelaborar la relación con la violencia, identificar las nuevas formas de tortura, y las condiciones de lucha y de supervivencia. Vivir el vértigo democrático enraizado en la relación entre tortura y migración, tanto en Europa como en otras partes del mundo, es inventar, sobre un suelo frágil, políticas democráticas de contra-violencia y de civilidad.
Índice. 1 Introducción: las incógnitas de la relación entre tortura y migración. – 2 Resistencia a saber. El imaginario de la guerra, de la tortura. 2.1 Consideraciones sobre la tortura y la migración. – 2.2 El nodo medular de la tortura: la tentativa de destrucción de la libertad política. – 2.3 El infierno de Dante. Trabajo sobre el imaginario. – 3 ¿Cómo poder pensar? Cuestiones de método. – 3.1 Cuestiones de méodo. – 4 Las actuales incógnitas de la historia. – 4.1 Historia: técnica devastadora y tortura. –Imaginar millones de muertos. – Aprehender para qué sirve un bidón de Zyklon B. – 5 Recorrer una aporía. – 5.1 Recorrer la aporía de la violencia extrema. – 6 Desplazamiento, horizontes, vértigo. – 6.1 La libertad política de moverse. – 6.2 Conclusión: vivir el vértigo democrático transpolítico.
1 Introducción: las incógnitas de la relación entre tortura y migración
Oigo ahondar el silencio
(Lorand Gaspar, poeta, fallecido el 9.10.2019)
Homenaje a una exiliada, heroína ordinaria:
A Kidest, joven eritrea sola con un hijo nacido en Suiza, deportada a Grecia por la fuerza, esposada.[1]
La violencia extrema[2] (Balibar 2010) y las luchas por la libertad política se despliegan en un contexto de incertidumbre global (Europa, Medio Oriente, Asia, China, continente africano, América Latina). Están atravesadas por contradicciones, vías muertas, incógnitas indescifrables. En el contexto actual de las hegemonías, es difícil comprenderlas, vivirlas, pensarlas, juzgarlas. La tortura es una de las formas de violencia extrema del entorno, en que se enmarca la migración atrapada por las turbulencias del planeta. La neutralidad ‘científica’ es imposible. Nuestras herramientas son inadecuadas. La negación, peligrosa. El terror atroz de la tortura estructural y cotidiana induce al sometimiento, a la inercia. La fuga, la resistencia, la creación son imprevisibles, frágiles.
La tortura ha ido incrementando[3] en la migración desde la década de 1980. Empleando el sentido genérico, no estrictamente jurídico, del término tortura, basta con señalar, como ejemplo actual, que, entre 2 y 3,5 millones de refugiados sirios han sido convertidos en arma geopolítica. Otro ejemplo. La desaparición es una característica estructural de las políticas migratorias, que exige ampliar la noción de tortura, para analizarla a la luz de la violencia extrema (en el sentido de Balibar). No puede considerársela solamente un mero dispositivo, una herramienta técnica de la violencia de Estado, de los poderosos. Es una política destructiva ejercida por los poderosos.
Responsables políticos, agentes del Estado, multinacionales, instituciones financieras, mafias, etc. practican la tortura. Los nuevos imperios y las metamorfosis de la guerra de conquista de nuevos mercados, perceptibles en la migración, nos plantean el reto de pensar conjuntamente violencia y creación, filosofía y política. Es pues necesario examinar las bases de la relación entre tortura y migración, la dialéctica entre la violencia extrema y las explosiones de lava de la democracia insurreccional, las dificultades de la filosofía política, del Estado, del derecho, de los derechos humanos (DDHH), del derecho internacional humanitario (DIH). El desafío no es producir un nuevo concepto técnico de tortura basándose en hechos relacionados con la migración, ni negar las políticas de tortura y de desaparición a escala continental practicadas por las dictaduras del siglo XX contra sus opositores políticos.[4]
El trabajo sobre la historia reciente, los afectos y el pensamiento lleva a identificar el peso de los miedos, de las incógnitas del conocimiento, del autoritarismo securitario (Insel, véase el sitio web exil-ciph.com), de los mecanismos de adaptación inconsciente (Amati Sas 2004) que impiden comprender la tortura, para intentar transformar la destrucción en supervivencia, el miedo en angustia, y liberar el poder político de la creación humana de la libertad política.
¿Por qué una violencia atroz y banalizada contra los migrantes? Para arrojar luz sobre el tema, es posible basarse en el postulado weberiano de la asimilación entre violencia y poder (Héritier 1996), y en la distinción que hacen H. Arendt y S. Weil entre fuerza y poder cuando reflexionan sobre la guerra en el siglo XX. Poder y fuerza imprevisibles que, hoy en día, se manifiestan en las metamorfosis de la guerra, y en las luchas de los migrantes y de los activistas solidarios (Caloz-Tschopp 2016a).
¿De qué modo y en qué términos la filosofía política podría aportar herramientas para pensar a la vez la fuerza del Estado y el poder de acción de los migrantes, de los exiliados, de los movimientos sociales que hacen a la relación entre tortura y migración? El desafío es inmenso: pensar la política como una dialéctica compleja entre dominación bélica e insurrección democrática, en un contexto mundial de des-civilización (Bozarslan 2019).
Al interrogarse sobre la relación entre tortura y migración, la filosofía y la política se ven enfrentadas al reto de detectar aporías – dificultades lógicas (del griego aporia, camino sin salida, dificultad, atolladero) para pensar y actuar –, explorando malestares, desasosiegos, dificultades para ver, pensar, juzgar, actuar. Nosotros nos enfrentamos al reto de reapropiarnos de la imaginación para pensar y juzgar no solo con los medios proporcionados por la tradición de la filosofía política, sino también más allá de ellos. En pocas palabras, de refundarla.
Partiendo del marco general histórico y actual de la globalización, que puede explicitar el análisis del esquema guerra, tierra, trabajo, capital, me propongo integrar en este trabajo el conflicto entre violencia y civilidad estudiado por Balibar.[5] El reto estriba en reflexionar sobre la relación entre tortura y migración, desde un marco político y filosófico que habrá que crear.
2 Resistirse a saber. El imaginario de la guerra y de la tortura
2.1 Consideraciones sobre la tortura y la migración
Cada vez que nos topamos con ella, quedamos atónitos ante la violencia inaudita, cruel, también ante las víctimas mortales; una violencia que paraliza, fuerza al silencio o a la ira, a la rabia, a otras muertes. Ella está presente de múltiples formas en los discursos, los gestos, las herramientas. Escuchar los silencios, los gritos, las palabras, los discursos. Comencemos por situar los términos tortura y migración, sin proceder aquí al análisis semiótico crítico (Fiala 2018) ni al desplazamiento semiótico efectuado en otro estudio.[6] Los trabajos sobre la génesis de los discursos que refieren a la migración, denunciando o legitimando la tortura, abundan en la investigación en ciencias sociales. Pero Schengen, Dublin, Frontex limitan la mirada. Desde otro ángulo, también Napoleón y los programas nucleares, como veremos.
La tortura, ese pulpo en las oscuras aguas de los Estados y las sociedades, tiene una larguísima historia. Extiende sus tentáculos devastando el mundo a lo largo de las rutas y los mares por donde huyen y son perseguidos (Chamayou 2010) migrantes, siervos esclavos, soldados, prisioneros de guerra, poblaciones desplazadas. Los tentáculos de la tortura bélica se extienden por todas partes. En la movilidad forzada del trabajo y de la expulsión, en la de los bienes y capitales. Y en la guerra. Nadie está a salvo.
La tortura es una relación de poder. La violencia de Estado, de grupos sociales, de individuos, ejercida con brutalidad, con crueldad sobre los cuerpos (Ulricksen 1998), supone un largo vínculo hecho de humillación, vulneración de la dignidad, sufrimiento, dolor, crueldad, suplicios, aniquilamiento físico y síquico sistemático (Viñar et al. 1989), un intento de destruir toda esperanza. Cruzado el umbral de la violencia sobre el cuerpo, el pensamiento del torturado es un límite que lo hunde en otro mundo del cual, a veces, no logrará regresar, o bien es un ínfimo lugar donde encontrará recursos de supervivencia. Angustias, enfermedades, suicidios, la invención de formas de resistencia son rastros indelebles de la tortura. A menudo se legitima la violencia para obtener confesiones (inquisición, terrorismo), o como castigo, pero su propósito « no es hacer hablar sino silenciar» (Sorini, Branche 2002). La tortura busca aniquilar, destruir la humanidad de los torturados, instaurar el sometimiento total por medio del castigo a todos los niveles, en todas las formas posibles, hacer desaparecer toda esperanza en la propia persona y en los demás. Su objetivo es el ataque radical a la « libertad de ser libre » (Arendt 2019), base de la libertad política de moverse de todos los seres humanos, entre ellos los migrantes, atrapados en el torbellino de la relación capital-trabajo y guerra (Caloz-Tschopp 2019).
Las descripciones muestran que la tortura intenta destruir las bases de la esperanza de autonomía, libertad, solidaridad humana. Una psicoanalista expuso que, en los momentos finales de la tortura, cuando aparecen « dos frentes de la supervivencia psíquica », se genera lo que llama « el objeto a salvar » (Amati Sas 2016, 69), una relación con el otro imaginado que el torturado cree poder salvar, y eso lo ayuda a sobrevivir.
La tortura se practica en individuos, pero es transindividual y transpolítica. Su propósito es instalar en el entorno, en la sociedad, un instrumento político totalitario, el terror (Arendt 1972) en mano de poderes absolutos, para paralizar, eliminar cualquier resistencia a la dominación del torturado, de sus allegados, de la sociedad. Se inscribe en una política de aniquilación (Veloso Bermedo 2018), y las políticas de desaparición se han convertido en su paradigma. Política de desaparición en las colonias, el imperialismo, las guerras, las dictaduras, y actualmente en las políticas migratorias. La ciudad de Juárez en México, los ahogados en el Mediterráneo, los muertos en los desiertos son los agujeros negros de los desaparecidos de la migración. La nada es la cara final de la tortura.
En resumen, la migración es una relación básica de poder, constituida por el esquema general guerra-tierra-trabajo-capital, donde se puede observar la relación estructural entre violencia, tortura y migración que forma parte de la cotidianeidad. La violencia bélica es inherente al capitalismo actual. La migración es constitutiva del capitalismo bélico y la tortura una forma de su violencia extrema. Ella se practica en las cárceles y en lugares de la vida diaria. La tortura forma parte de las lógicas de explotación y sobreexplotación de los trabajadores, de los humanos superfluos (Arendt 1972), de la subordinación e insurrección de los migrantes y de quienes practican la hospitalidad, la solidaridad, la igualdad. La generalización de los campos de internamiento en las fronteras internas y externas del apartheid (Caloz-Tschopp 2004a) y el aumento de los delitos de rescate y solidaridad (250 sentencias en 14 países de la UE) son señales inequívocas de ello. En materia de migración, puesto que las políticas migratorias y del derecho de asilo son fruto del sistema Estado-nación que domina en el mundo, la violencia de Estado merece una atención especial.
La violencia extrema, incluyendo la tortura, es un hecho estructural de la globalización. Un enfoque fenomenológico que describa los casos y las múltiples formas de tortura no puede abordarla exhaustivamente, ni determinar su significado. Sus huellas también pueden leerse en la destrucción de la naturaleza. Las políticas de desaparición, de nihilismo extremo son la expresión máxima de la no-política, ostensible en los muertos en el mar sin sepultura, en los campos-prisión, en las fronteras, los femicidios, las desapariciones, las políticas de las dictaduras totalitarias liberales. También se la detecta en la política migratoria de la UE que se resume a un extremo utilitarismo, en la sobreexplotación de los trabajadores migrantes, el brain-drain (fuga de cerebros, clandestinidad, precariedad extrema, y superfluos descartables del caótico mercado laboral), y en las políticas de las fronteras militarizadas. Para comprender el alcance de la tortura banalizada, para comprender su significado, se puede postular que los migrantes en movimiento, expulsados, perseguidos, son la representación por excelencia de las transformaciones de la relación capital-trabajo, de la destrucción del planeta, de la guerra y del deseo de libertad política que se expresa en las luchas que llamamos desexilio. Entonces, si la tortura se inscribe estructuralmente en la violencia extrema ¿por qué plantean tantos problemas, negaciones, rechazos los trabajos sobre la violencia y la tortura en la migración?
2.2 El nudo medular de la tortura: la tentativa de destrucción de la libertad política
Planteemos de entrada una tesis exploratoria. Se le asigna a la tortura la finalidad utilitaria de protección de las poblaciones, pero su objetivo final es el sometimiento a cualquier precio. Un enfoque humanitario, con técnicas médicas, el care, no es suficiente. El poder de la violencia extrema a través de la tortura y la desaparición es intrínseco a la dominación capitalista globalizada que intenta imponerse apropiándose del Estado. El terror a las nuevas formas de guerra produce miedos, angustias, enormes resistencias, negaciones, pero los Estados y las sociedades se rehúsan a reconocer su gravedad.
Tortura, migración, están en relación estructural. Ambas atraviesan la historia de la humanidad, con la institucionalización de la explotación del trabajo y los recursos en el capitalismo entre los siglos XVIII y XX, mientras se proclamaban los derechos humanos después de dos guerras mundiales. Desde la década de 1980, a la par que se afirman la libertad de circulación y la justicia (Schengen), una nueva intensificación de la violencia da muestras de la presencia institucionalizada de la tortura en las políticas migratorias a nivel mundial. Es necesario analizarla para transformar el imaginario filosófico y político, la conciencia social, para luchar, para criticar las lógicas, el endurecimiento, más aún la abolición de los derechos (Tafelmacher 2019), para crear nuevos espacios de protección, de civilidad, y derechos para combatirla.
La resistencia a la violencia de los migrantes y de los movimientos sociales es una especie de ‘retorno de lo reprimido’ del deseo de libertad política, que crea malestar, deslegitima la violencia de Estado. El Estado responde con medidas securitarias (encarcelamiento administrativo, campos de internamiento, expulsiones, delitos de solidaridad).
Sobre la tortura y la migración abundan los trabajos, documentados interdisciplinarios, intercontinentales. Generalmente, la violencia estructural contra los migrantes se aplica por delitos administrativos (partir, sobrevivir, oponerse a la prohibición de ingreso o a las expulsiones). Un castigo sin culpa. Hablando claro, la violencia se concatena con el sistema estatal que exige la servidumbre de los migrantes. El lenguaje, los dispositivos, las herramientas de la tortura están cambiando. Si bien existen criterios sobre la tortura en la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes[7] de la ONU de 1984, basada en los derechos humanos, no se llega a identificar su objetivo político (someter), su gravedad des-civilizacional (Bozarslan 2019) con tendencia genocida y destructora observable en el entorno del cual forma parte la migración. La violencia no es objeto de prevención seria, de condenas, sanciones, reparaciones acordes con la gravedad de los actos.
El derecho nacional e internacional de los Estados soberanos sobre migración y tortura tiene lagunas, zonas oscuras, agujeros negros. Instituciones como la Comisión Europea de Derechos Humanos (CEDH), textos como la Declaración de Derechos Humanos prohíben que los Estados practiquen la tortura. Pero formalizar la existencia de la tortura en los derechos fundamentales es una forma de nombrarla sin abordar de frente el nudo medular político del sentido de la tortura: la negación del deseo de libertad política, y la legitimación e imposición del sometimiento a cualquier precio. Hasta la aniquilación. Frente a los actos de tortura actuales y las lagunas jurídicas, el vocabulario diplomático para acotar los conflictos, y la delegación de responsabilidades (por ej. el fin del sistema de reparto de refugiados ante la situación de emergencia) provocan indignación.
¿Las tensiones entre sometimiento e insurrección, la manipulación del odio, tendrán acaso el cometido de evitar en las políticas migratorias lo que Vidal-Naquet (1972)[8] llamó, refiriéndose a la tortura colonial en Argelia, un «retorno de lo reprimido», mientras la mayoría de los Estados de inmigración torturan y/o toleran la tortura?
La huida de los migrantes, los delitos de solidaridad, visibilizan el peso de la violencia, la tortura, los crímenes, el cinismo de los intereses, las transformaciones de las políticas de desaparición, a través de la acción de los migrantes, de la hospitalidad de los activistas solidarios, de las ONG que se oponen a la selección en las fronteras, abren refugios, visitan los campos de internamiento y. las cárceles, se instalan a lo largo de las rutas de expulsión, intervienen ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la CEDH, etc. para recordar los derechos fundamentales.
2.3 El infierno de Dante. Trabajo sobre el imaginario
La tortura se relaciona directamente con la guerra, con el apartheid de las políticas migratorias, laborales, etc.. En cualquier parte del mundo, la relación entre tortura y migración es, en efecto, una relación de violencia con una filosofía de apartheid (Monnier 2004), de separación, de jerarquización, de selección, de inclusión-expulsión de los migrantes en numerosas fronteras, que implica la sobreexplotación y la negativa a la plena participación cívica de todos en los asuntos públicos, como explica Arendt (2019).[9] Las fuentes históricas del apartheid proceden de regímenes institucionalizados (nazismo, Sudáfrica). Al reproducir la dualidad bélica amigo-enemigo de Carl Schmitt en las relaciones de clase, sexo, raza, el apartheid se inscribe en la guerra (Caloz-Tschopp 2016a). La violencia se vuelve tan obvia, tan inaudita, que todo se confunde, se pierden los puntos de referencia, incluso los del apartheid de las democracias securitarias. Los relatos de las increíbles experiencias de los migrantes y los activistas solidarios en las fronteras ponen en evidencia la discrepancia con los discursos de Estado que esencializan, naturalizan (racismo) al otro (Sayad, Guillaumin, véase el sitio web exil-ciph.com). Dicen cosas diferentes.
Las depredaciones y la sobreexplotación de los seres humanos y de la naturaleza en un espacio globalizado cambiante, y las metamorfosis de las luchas y la guerra son estudiadas con herramientas que fueron construidas en la historia del conocimiento, y están mostrando sus limitaciones. La invención de métodos y de conceptos (antropoceno, capitaloceno, occidentaloceno, etc.), pone de relieve la necesidad de una filosofía, una teoría política, una epistemología y una metodología nuevas, la necesidad de usar conceptos en movimiento que puedan describir el complejo entramado entre guerra, tierra, trabajo y capital. Los migrantes son una especie de avanzadilla, sacrificada en numerosas fronteras. Se enfrentan al movimiento ilimitado del valor del trabajo, expresado por el crecimiento, la destrucción, el sometimiento a cualquier precio que niega a un tiempo la libertad de moverse y los límites planetarios, uno de cuyos indicadores son los migrantes que huyen.
¿Qué podemos percibir y qué no con respecto a las metamorfosis de la guerra y de la paz[10] en la relación entre tortura y migración, si vamos más allá del concepto de tortura de la Convención que integra el arsenal de los derechos humanos? En pocas palabras, las categorías de la Convención merecen un enfoque crítico de la soberanía estatal, de conceptos como el de intencionalidad, relacionándolos con un enfoque transindividual (Balibar 2018) y transpolítico (Caloz-Tschopp 2019). Ese trabajo teórico crítico es imprescindible para conmutar la fuerza de soberanía del Estado en poder democrático, y reelaborar la cuestión de la responsabilidad. Por otra parte, en el trabajo de identificación y descripción de la violencia, ¿es suficiente hablar de abusos, excesos, malos tratos, falta de asistencia, protección de los derechos? ¿Cómo y por qué hay que hablar de tortura? ¿Para detectar qué?
Dos hechos que vive la migración en las fronteras permiten visualizar las transformaciones de la tortura apreciables en las políticas migratorias: el femicidio y los campos de internamiento. El femicidio se ha convertido en una práctica común en las fronteras, aunque no se lo reconoce. Ciertas investigaciones vinculan femicidios y genocidios, campamentos y genocidios en la colonización africana (Brepohl 2019). Asimismo, desde la década de 1980 (Schengen), se traspasó un límite con la institucionalización de los campos de refugiados en Alemania,[11] y luego su ampliación en redes de cárceles por toda Europa y en sus fronteras externalizadas. A pesar de duras luchas, ni unos ni otras son denunciados ni condenados como crímenes contra la humanidad. Estos hechos se inscriben en las políticas de desaparición que son, de cierto modo, el paradigma del capitalismo actual.
En 1957, R. Antelme, prisionero en Birkenau y Dachau, había advertido sobre la relación entre la explotación y los campos después de la Segunda guerra mundial: « No existe diferencia de naturaleza entre el régimen normal de explotación del hombre y el de los campos. El campo es simplemente la imagen nítida del infierno más o menos encubierto en el que aún viven tantos pueblos » (Antelme 1957, 123). Articulaba explotación y campos, historia, presente y futuro.
El actual infierno de Dante es la situación de las mujeres migrantes ‘clandestinas’, los campamentos (dormitorios comunes de los trabajadores en China, campos de internamiento en Grecia, cárceles en Libia, etc.). Tenemos que articular el femicidio y los campos-prisión situándolos en la relación capital-trabajo-guerra para poder inferir, por un lado, la lógica de desaparición y por otro, en qué se convierten las relaciones sociales de clase, sexo, raza, las luchas en el mercado mundial del trabajo y del capital, y las transformaciones de la guerra y la tortura.
3 ¿Cómo poder pensar? Cuestiones de método
3.1 Cuestiones de método
Podemos comenzar por preguntarnos qué significa la aparición de la palabra tortura en los discursos sobre la migración. Podemos luego examinar qué implica epistemológicamente la transferencia de la noción de tortura, cargada de la herencia de la larga historia política de la humanidad (inquisición, esclavitud, colonización, dictaduras, poderes por fuera del Estado, paramilitares, mafiosos, etc.), a la migración. ¿Legitimación oculta de la violencia? ¿Comparar lo incomparable? ¿Se justifica la operación analógica entre violencia y tortura, y entre tortura y migración? Postulo que los hechos nos llevan a plantear un desplazamiento teórico y práctico para comprender y superar las dificultades que subyacen en estas preguntas.
¿Cómo pensar hoy en día la relación entre tortura y migración, partiendo de constataciones de violencia extrema? ¿Qué nos revela sobre las políticas migratorias la presencia de la tortura? ¿En qué sentido, cómo y por qué podemos hablar de políticas de tortura en el ámbito de las políticas migratorias? Es posible apoyarse en la Convención. Pero hace falta dar un paso más para comprender su significado. El reto estriba en pensar con los medios (herramientas) y estilos existentes, pero también ir más allá para insertarse en la dialéctica entre destrucción y movimiento de creación socio-histórica del conocimiento, del arte (Sustam 2016), de la libertad política.
En primer lugar, en circunstancias en que lo urgente, lo insoportable está en todas las pantallas, podríamos preguntarnos: ¿las relaciones entre tortura y migración, deben ser abordadas como una cuestión humanitaria hacia las víctimas que inspiran piedad y una culpabilidad que se vuelve odio, o como una cuestión política y filosófica que incluye las transformaciones del deseo de libertad política y de la guerra? Prima facie, cabe señalar que la Convención se enmarca en el corpus de los derechos humanos (DDHH) y no en el del derecho internacional humanitario (DIH); en consecuencia sitúa la tortura como una violación de los derechos fundamentales.
Posicionar la relación entre tortura y migración en lo humanitario sería considerar de entrada a los migrantes como víctimas, no como sujetos de derecho, e incluirlos en el derecho de la guerra (masas), explica un jurista que distingue los DDHH del DIH (Rigaux, disponible en el sitio web exil-ciph.com) y conmina a tomar en cuenta los desafíos mercantiles y geopolíticos del humanitarismo.
¿Cómo pensar la relación entre tortura y migración desde la filosofía política integrando este postulado? ¿Debemos verla como otra señal de la inflexión de una política de la paz hacia una no-política, como la desviación de una cultura de los derechos (con el Estado nacional soberano ejerciendo presión en un territorio, sobre poblaciones) hacia una cultura del mercado humanitario y de la guerra, proceso que se está acelerando, especialmente en el campo de la migración desde la década de 1980, al tiempo que las luchas son cada vez más visibles, más duras (Caloz-Tschopp 2016c)? El desgaste, el cansancio y también la desobediencia cívica (Caloz-Tschopp, 2020) son indicadores de la transformación de la violencia. Los cambios institucionales de los últimos treinta años inducirían a realizar esta interpretación. Es necesario dar un paso más para identificar las implicaciones de la violencia extrema, casi generalizada y banalizada, de la cual habla Balibar (2010). Entonces, ¿con qué instrumentos acercarse hoy en día al fenómeno de la tortura como forma de violencia extrema, a la tortura, su presencia supuesta y constatada en la migración, a sus objetivos?
Discernir las transformaciones de la tortura como una forma de violencia y sus implicaciones exige cambiar, considerar desde otros puntos de vista conceptuales, teóricos, epistemológicos, metodológicos la violencia contra los migrantes. Un abordaje de la relación entre tortura y migración implica desarrollar una filosofía política que cuestione la larga historia de la soberanía estatal sobre los cuerpos, el suelo, las armas, los bienes etc., y la violencia de Estado legitimada. El gran reto es el ataque actual y frontal, y el futuro de la política y de la filosofía en el mundo.
La mayoría de los Estados[12], supeditados a las ‘prohibiciones’ de principio de los documentos de instancias europeas (CEDH) y de la ONU (Declaración de los DDHH), declaran que han abolido la tortura aunque la siguen practicando con total impunidad en la migración y en otros ámbitos, vendiendo armas mientras pronuncian discursos en las guerras «humanitarias» (Brauman 2001, 2018). Extraña paradoja: de las revoluciones liberales, pero apoyándose en la colonización, en el siglo XVIII surgieron valores (libertad, igualdad y fraternidad) circunscritos a los imperios, y en esos imperios a las clases dominantes, en tanto la ciencia de la época inventaba la ideología racista (Guillaumin 2000).
La relación de tortura forma parte de las políticas laborales, de la llamada movilidad de los migrantes, soslayando que ésta sea forzada, y por lo tanto violenta. Es una grave señal de alarma[13] sobre las metamorfosis de las luchas y de la guerra, que está aflorando en la conciencia colectiva mundial. Ella caracteriza el estado del mundo donde se mueven los trabajadores hiperprecarizados, atrapados en las turbulencias de las lógicas de apropiación, caza, saqueo, sobreexplotación, destrucción. La violencia actual es más difícil de describir que antes; las fronteras entre los tipos de violencia y de crímenes se están difuminando. Las transformaciones de la geopolítica en Medio Oriente, la guerra en Siria, en el Yemen son algunos ejemplos (violencia intraestatal, interestatal, transnacional, diversidad de temas políticos). ¿Y qué ocurre con la tortura? ¿Dónde, cuándo, cómo, por qué deberíamos detectar el paso institucionalizado de los malos tratos a la tortura, de la violencia de Estado al crimen de Estado (Vahabi 2019) en la migración?
La cuestión es compleja. Remite a un desplazamiento, a una renovación de la epistemología, de posiciones, de opciones metodológicas, de herramientas de exploración en el trabajo de investigación. Las luchas de las mujeres migrantes ‘clandestinas’ en las fronteras, y especialmente en los campos-prisión de las fronteras, son puntos claves para la observación y la acción.
La tortura forma parte de las políticas laborales, de las políticas de seguridad desde setiembre de 2001 (Patriot Act, prisiones secretas, Guantánamo), de las políticas migratorias y del derecho de asilo, pero las palabras « tortura y otras penas o tratos inhumanos y degradantes» no figuran como prohibiciones sancionables en los documentos (Pacto Mundial sobre las migraciones de 2018, leyes nacionales). El Estado de derecho, el derecho vigente chocan con los límites de la violencia de Estado y los vacíos legales.
El desafío histórico actual es constatar la presencia de la tortura en la nueva conformación caótica de los imperios, del mercado globalizado del trabajo y del capital, que entrañan la circulación, la movilidad obligada combinada con el ilusorio sedentarismo de los pueblos, e interpelar sus relaciones con la historia y la guerra. Cuando se observan Schengen, Dublin, los campos-prisión, Frontex, no se puede hablar de laboratorio de prueba, de conejillos de indias, de abusos, de excesos en la seguridad, etc. La presencia estructural de la tortura indica une transformación de la violencia bélica en las relaciones de poder y en las relaciones entre tortura y migración. Es también una de las señales de la destrucción del medio ambiente[14] en todo el mundo.
4 Las actuales incógnitas de la historia
4.1 Historia: técnica devastadora y tortura
Hacer un corte en la historia puede habilitar a sumar interrogantes sobre la técnica y la tortura para comprender la relación actual entre tortura y migración. Una opción es detenerse en la historia reciente (finales del siglo XIX-siglo XX), en el imperialismo de la Primera Guerra Mundial y sus «efectos boomerang» que describe R. Luxemburg (Caloz-Tschopp 2018), en la Segunda Guerra Mundial con Auschwitz e Hiroshima (Traverso 1997). La desaparición de imperios (austro-húngaro, turco, ruso), la supremacía del Estado-nación y el surgimiento de nuevos imperios en proceso de reconfiguración, la intervención en esas guerras precedidas de masacres y genocidios coloniales (Namibia) e imperiales (Armenia) significó el paso a la historia en la cual la cuestión de la integridad, de la mortalidad no solo refieren a la tortura, al asesinato industrial masivo, a una civilización del saqueo, a la destrucción, sino a la aporía del auto-exterminio de la humanidad de la faz de la Tierra. Con respecto a la Segunda Guerra Mundial, el análisis de dos casos hizo correr ríos de tinta: los procesos de A. Eichmann y del piloto de Hiroshima. El análisis de estos dos casos, que no son únicos[15], situó la destrucción en la historia (Auschwitz e Hiroshima). Su conflictiva elaboración conduce a una ruptura con lo que Castoriadis llama el sujeto socio-histórico y a una aporía fundamental del pensamiento sobre la violencia ante el desafío de incorporar las conquistas, los colonialismos y el imperialismo que precedieron y acompañan al capitalismo.
Para continuar la reflexión desde la actualidad, cuando la crisis medioambiental amenaza las bases de nuestra civilización y la mismísima existencia (Magnénat 2019), volvamos un instante a un camino abierto por una psicoanalista (Silvia Amati Sas) y un filósofo (Günther Anders) que examinaron las relaciones entre ciencia, técnica y civilización, y su influencia directa sobre la expansión de los dispositivos de tortura, incluido en la migración, a la par que complejizaban la cuestión de la intención, la alienación, la conciencia, el pensamiento, la responsabilidad. El desarrollo de la energía nuclear, sus ‘accidentes’ y consecuencias, por ejemplo, vuelven a poner en agenda esos temas de los años 1950-70.
La lectura consecutiva de ambos discursos permite analizar problemas filosóficos y políticos en una civilización técnica que se desarrolla con el capitalismo avanzado y puede reflejar hoy en día la intencionalidad y la responsabilidad de los Estados en el conjunto de las políticas, incluso en la relación actual entre tortura y migración. Ellos pueden ayudarnos a pensar las relaciones entre trabajo y capital en el mundo, los femicidios, los campos de internamiento, las muertes de los migrantes en el Mediterráneo y en los caminos del exilio.
Imaginar millones de muertos
El desarrollo de la ciencia y de la técnica guarda relación directa con la guerra y la tortura al involucrar el conocimiento, la responsabilidad y la culpabilidad, pero complejizándolos. Esto se ve claramente en la migración. Es una tesis sostenida por muchos autores. Los gestores de la invención de la bomba atómica crearon una civilización de megamuertos (Amati Sas 1984), « de obsolescencia del hombre » (Anders 2011). Releer el discurso de Albert Camus y otros discursos escritos días después del bombardeo de Hiroshima permite medir la muy limitada capacidad de comprender su impacto y sus incalculables consecuencias. La autodestrucción de la humanidad se vuelve inimaginable, y ni siquiera es perceptible por la imaginación, los afectos, el pensamiento, la conciencia. En pocas palabras, la intencionalidad, que supone afectos, pensamiento y conciencia, desaparece como la actitud subjetiva en que se basa la responsabilidad, escriben una psicoanalista y un filósofo marcados por la guerra total, los campos de exterminio, la bomba nuclear y la civilización técnica que acompaña esos hechos históricos. Esto puede llevar al determinismo, a olvidar la libertad política ante el poder absoluto de la técnica, de los técnicos, de los burócratas.
La creación científica de traumatismos y de situaciones extremas para manipular a los hombres es lo propio de nuestra civilización. Iniciada en los laboratorios, llevó a la tortura institucionalizada y a los campos de concentración […] El deseo de dominar la naturaleza, propio de la ciencia, llevó a que algunos hombres desearan dominar a otros hombres hasta sus últimas defensas. (Amati Sas 1984, 14)
Estamos hablando de muertos y de muertes masivas no cuantificables (aunque la estadística sea la herramienta por excelencia de la migración y de la política de cifras de las policías). El Estado que lanzó bombas para que Japón terminase la guerra, y sobre todo para ponerlo de rodillas ante el nuevo imperio vencedor, quería imponer su poder en el mundo. Estados Unidos, que lanzó la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki, no fue condenado por crímenes contra la humanidad. Puso en marcha el Plan Marshall para controlar la reconstrucción de Europa.
Imposible calcular. Imposible describir positivamente el no-ser, la destrucción. El concepto teológico de ‘mal’, remplazado por el concepto de ‘mal radical’ de Kant y de ‘mal político’, expresado como « banalidad del mal» por Arendt (1966) puede describir el fenómeno pero no pensarlo. «Tenía que entender», dijo ella en varias ocasiones. Ampliaría entonces su investigación sobre el pensamiento (Arendt 1981) y dictaría conferencias sobre el juicio. Por su parte, la psicoanalista inventa la palabra megamuertos preguntándose si es una « unidad de medida» o una « metáfora » (Amati Sas 1984). Escribe:
Para interesarnos en la guerra nuclear, necesitamos vencer nuestras resistencias, porque el tema remueve las convicciones y certidumbres que protegen nuestra felicidad. Se trata de comprender el significado de elegir la política nuclear concebida como signo de poder, de disuasión por el terror, y de evaluar de qué forma la seguridad es tomada como rehén por algunos Estados que practican la imprevisión y la irresponsabilidad que nos rodean en nuestro mundo nuclear, y eso en un contexto de guerra en mutación, de mundo multipolar. Es una guerra de cantidades inimaginables. ¡Sentimos que estamos entregando pasivamente el destino de todos a los signos matemáticos y a los concretos datos estadísticos e informáticos! Los valores de la era tecnológica son valores fríos y carentes de afectos que sirven a nuestra necesidad de escondernos a nosotros mismos nuestro miedo y angustia de la muerte. (Amati Sas 1984, 9)
Imaginar millones de muertos, ya es consolarse alperder la desmesura de la cuestión vinculada a la destrucción. Amati expresa que la perspectiva de la guerra nuclear es « la suspensión del proyecto de vida de la humanidad », y la destrucción de la humanidad y de todos los seres vivos.
Aprehender para qué sirve un bidón de Zyklon B
En esa misma época, un filósofo exiliado de Europa durante 14 años, que la guerra de 1914-18 y luego Auschwitz e Hiroshima marcaron para siempre, atormentado por lo que llamó la obsolescencia del hombre (Anders 2010) y un « mundo sin hombres» (1950-70), tras desmoronarse al conocer lo acaecido en Hiroshima, exponía su pensamiento en la entrevista publicada con el siguiente título: ¿Y si estoy desesperado, qué quieren que haga? (Anders 2001). Un tiempo después, habiendo visitado Hiroshima, escribió Hiroshima está en todas partes, ¡publicado en francés en las Editions du Seuil en 2008! Hablaba entonces de nihilistas activos. En la citada entrevista también evoca sus trabajos sobre patología de la libertad, discurre sobre Weltfremdheit des Menschen (extrañamiento del hombre con respecto al mundo), « el apocalipsis sin reino », el fin de la humanidad por la autodestrucción sin sentido, sin tribunal supremo, sin redención. Anders se dedicó a estudiar los casos del piloto de Hiroshima y de la guerra de Vietnam, trabajando simultáneamente sobre una filosofía de la técnica convertida, para él, en un mundo autónomo que decide nuestra existencia. Él se opone a Heidegger, replanteando desde otra perspectiva la cuestión de la técnica. Su método, explicado por Roger Pol-Droit[16], se basa en la exageración y la atención a las más mínimas huellas de lo que se niega, se pasa por alto, se solapa: la desrealización del mundo, la deshumanización de lo cotidiano, la mercantilización general.
Al constatar los límites y derivas de los filósofos, cuando trabaja sobre sus obras, Anders toma distancia de ellos y va a desarrollar su propia filosofía autónoma minoritaria.
Imaginar el significado de un bidón de Zyklon B o de un reactor atómico que suprimen a millones de personas cambia radicalmente el trabajo del pensamiento y la cuestión de la conciencia, la intencionalidad, la alienación y la responsabilidad. Preguntándose por los límites de la tradición filosófica y las duplicidades de algunos filósofos, Anders afirma que estamos en un mundo de físicos, de ingenieros telosblind (acrónimo que combina la palabra griega telos, objetivo, fin, y la inglesa blind, ciego) (Anders 2001).
« Aunque la imaginación por sí sola sigue siendo insuficiente », escribe Anders (2001, 68), entrenada de forma consciente, capta (nimmt) muchísima más « verdad » (mehr « wahr ») que la « percepción » (Wahrnehmerung). Para estar a la altura de lo empírico. Por muy paradójico que parezca, debemos movilizar nuestra imaginación. Ella es la « percepción de hoy », escribe Anders (2001, 68). ¿Ínfima traza, infra-libertad política?
Sobre este punto concuerda con un filósofo griego exiliado, Castoriadis – cuyo marco de referencias no son la fenomenología de Husserl y de Heidegger sino el marxismo, el psicoanálisis, la economía y la antigua Grecia – que trabajó entre 1960 y 1989 sobre la imaginación radical y la creación humana, tras fundar el grupo Socialismo o Barbarie.
Para Anders, no se trata de una cuestión moral sino de cognición, pues ciencia y conciencia siempre van unidas. Quienes provocaron genocidios no son peores que las generaciones anteriores, escribe. « En mi correspondencia con el piloto de Hiroshima, Eatherly, forjé el concepto de ‘inocente culpable’ (schuldlos Schuldigen). No afirmo que ‘el hombre’ sea más malo, pero digo que sus acciones, a causa de la enormidad de las herramientas de las que dispone, se han vuelto enormes » (Anders 2001, 69). Refiriéndose a la masacre de My Lai en Vietman, Anders agrega un elemento a su pensamiento: el del « asesinato indirecto », con máquinas (pensamos en los drones). La intervención ya no es directa sino a distancia, lo que disminuye la percepción de los hechos y sus consecuencias. « La situación en que nos encontramos no es más la de la Segunda Guerra mundial, cuando se bombardeaba desde arriba, sin ver lo que se hacía »; estamos ante un tercer tipo de situación, « en la que imitamos nuestras herramientas, para ver por fin algo de lo que hacemos» (68-69). Para describir la alienación que produce la técnica, Anders utiliza las palabras «exculpación» (Verharmlosung) y « embellecimiento » (Verniedlingug) «supraliminal », significando que son «acciones demasiado grandes para poder ser concebidas por el hombre » (72) y por lo tanto registradas, grabadas en la memoria. Demasiado grandes para ser percibidas o recordadas (memoria). La brecha entre producción e imaginación obliga pues a una crítica radical de los conceptos tradicionales y de las facultades humanas (imaginación, percepción, intencionalidad).
Posteriormente, Amati Sas se refiere a su colega Bleger (Caloz-Tschopp 2014; Amati Sas 2016), que no vivió en la vieja Europa sino en Argentina, y del cual podría decirse que presintió la dictadura y la política de desaparecidos cuando explora los mecanismos de ambigüedad, adaptación y extraña familiaridad que tornan aceptables la destrucción, la práctica del exilio forzoso, el aislamiento, el terror político a través de la tortura.
Otro psicoanalista latinoamericano, Marcelo Viñar, hace hincapié en la función del terror en la tortura, concepto clave de Arendt para describir El sistema totalitario (Arendt 1972): aterrorizar al torturado y a su entorno para inmovilizar, someter a la sociedad. Él destaca la importancia del terror político en las dictaduras y que el trabajo del analista para luchar contra la tortura no es una técnica médica de ‘resiliencia’ sino una relación situada en la historia y la política, con sus herramientas específicas basadas en la recuperación del poder del inconsciente, de la palabra, del pensamiento (Viñar et al. 1989; Viñar 2018). Su enfoque permite un análisis crítico y concreto de las herramientas profesionales y políticas, no solo de los médicos sino de todas las profesiones.
Consentimiento y resistencia para sobrevivir. Amati Sas se pregunta: «¿Cómo es posible que aceptemos lo inaceptable, que toleremos cualquier cosa ? ¿Qué mecanismo psíquico permite que tomemos las cosas más graves como si fueran obvias?» (2014, 14). « Para adaptarnos a nuestra cultura tecnológica de masa, tan confusa e invasora a través de los medios de comunicación, gran parte de nosotros debe permanecer (o incluso volverse) ambigua» (16). Ella aporta las nociones de indiferenciación, de núcleo aglutinado arcaico, «conjunto de afectos indiscriminados y sin organización ni jerarquía » (16), base de la ambigüedad, conceptos resaltados por el psicoanalista José Bleger. Este concepto permite la circulación de la angustia (vulnerabilidad psíquica y sentimiento de impotencia), pero cuestiona la solución propuesta por los poderes militares: « no nos plantean una opción de vida, sino un desafío de supervivencia a través de una fría manipulación » (17). Pretenden « ofrecer la seguridad a través de un sistema altamente mortífero » (17).
Los vínculos entre traumatología, vulnerabilidad y adaptabilidad psíquica también pueden ser elaborados en la relación entre tortura y migración. El mandato analítico implica un trabajo de fortalecimiento del insight, de la simbolización, la elaboración del conflicto, la integración de la personalidad, « es decir la autonomía del pensamiento y de la persona » (Amati Sas 2014, 18). Ella recuerda que, ante el peligro nuclear, Einstein hacía un llamamiento a una « forma de pensar radicalmente nueva » (Einstein, Russell 1955). Subraya que, desde la prohibición del canibalismo y del incesto, tenemos el desafío de crear una nueva prohibición, «una evolución fundamental, transcendental» (Amati Sas 2014, 19).
Para Anders, la Ética a Nicómaco de Aristóteles no nos ayuda a pensar la situación actual. El valor, el consuelo y la esperanza tampoco. La aporía sobre la percepción como fundamento de la intencionalidad lo lleva a «conservar el mundo antes de transformarlo» (Anders, 2001, 77) y a inventar una nueva filosofía y un nuevo lenguaje a partir de la constatación de la obsolescencia del hombre. Anders, que había asistido a los cursos de Husserl y de Heidegger en la universidad alemana, se volvió luego muy crítico con respecto a Heidegger y militó activamente contra la industria nuclear y la guerra de Vietnam (fue miembro del Tribunal Russell).
En resumen, para estos autores, el peso del determinismo de la civilización capitalista y de la técnica expresada como obsolescencia del hombre, guerra ‘total’, nuclear, genocidios, terror, tortura institucionalizada, ataca la esperanza positiva en la libertad política y redobla la exigencia de actuar donde sea posible (la esperanza, la desesperación, el valor no le interesan a Anders). Ellos inventan una nueva filosofía, y demandan un trabajo sobre las dificultades para pensar y elaborar el conflicto político integrando la historia del siglo XX. Para ambos autores, como para Einstein, Arendt, los investigadores de la Escuela de Frankfurt (razón instrumental), etc., la reapropiación del pensamiento de la filosofía y de la política es fundamental. Ellos muestran que la tortura intenta destruir los cuerpos, los afectos, la capacidad de pensar, el deseo de ser libre. De ahí que Anders haya retomado la cuestión de la imaginación y los psicoanalistas el trabajo sobre el inconsciente individual y social ante la violencia de Estado (Puget 1989).
¿Cómo pensar dentro de una casa en llamas? se preguntan hoy los investigadores de la crisis ambiental (Magnénat 2019). El término incluye la migración. ¿Cómo podemos aprehender la relación entre tortura y migración, que forma parte de la herencia histórica del vínculo entre violencia, pensamiento, conciencia y técnica, y ser capaces de superar la impotencia, la indiferencia, la apatía para modificar nuestras formas de vida y reapropiarnos del poder de la libertad política? Desde una perspectiva fenomenológica, algunos investigadores describieron los muros, la civilización militar de los alambres de púas (Razac 2008) de las fronteras fortificadas, de las cercas para el ganado que remiten a la parcelación terrestre de la propiedad privada interpretada en clave de declive de la soberanía estatal (Brown 2009). Esas descripciones han captado las lógicas de apartheid sobre la tierra, en las cabezas, en los afectos. Para superar la impotencia, la reflexión y las luchas en las fronteras – agitados y caóticos lugares de múltiples conflictos y contradicciones en la relación trabajo-capital-guerra –, no deben centrarse únicamente en la dinámica de la expulsión, sino en el conjunto de lógicas, dispositivos, herramientas de separación, inclusión/expulsión,[17] clasificación y priorización, y en la presencia y nueva calidad de la violencia que revelan la tortura y el torpor ante hechos inaceptables.
5 Recorrer una aporía
5.1 Recorrer la aporía de la violencia extrema
Detengámonos en una aporía que surge del enfoque filosófico de investigación crítica y se vincula directamente con la tortura y la migración, para comprender sus desafíos políticos y filosóficos. Ella es una especie de nudo gordiano en los fundamentos de la tortura y de la relación entre tortura y migración. En la relación entre tortura y migración, ¿cómo pensar y salir de la violencia extrema, contenida en la violencia de Estado y en el crimen de Estado que paradójicamente produce un efecto anestésico?
Tenemos la violencia de los poderosos, la violencia de Estado, la violencia de la resistencia que interpela Ahmet Insel (véase el sitio web exil-ciph.com) cuando reflexiona acerca de las huelgas de hambre en las cárceles turcas y sobre una política para la paz. Tenemos la violencia extrema, que Balibar descubre al releer a Clausewitz cuando éste observa a Napoleón, e integrando la historia y el presente, identifica una cualidad de la modernidad capitalista bélica que revoluciona profundamente nuestro enfoque de la política y de la filosofía.
La violencia extrema, con las urgencias y los límites del planeta, se transforma en un nuevo imperativo filosófico y político de civilidad. Tortura y Democracia no son compatibles. Veremos que luchar contra la tortura implica aceptar vivir el vértigo democrático.
La reflexión sobre la violencia extrema retoma los problemas y las posturas de Amati Sas, Anders, Arendt, Viñar, replanteándolos desde otro ángulo. La relación entre tortura y migración muestra que tipificar la tortura basándose en conceptos, en escalas de clasificación de los crímenes, contentándose con los criterios de la definición de tortura de la ONU, no permite luchar contra la tortura. ¿Qué hacer entonces? Si se considera la tortura como una compleja maraña de múltiples y heterogéneos actos de terror, de violencia extrema con efectos imprevisibles, ya no es posible, con la ilusión de definir niveles y límites, contentarse con un enfoque humanitario, utilitarista, con el pensamiento de un Estado-nación soberano, un pensamiento calculador, un pensamiento que se limita a definir niveles de violencia.
La solución común de la aporía se basa en límites (¡nunca más!), normas, criterios jurídicos, procedimientos para el derecho penal de los derechos humanos. Para Balibar, su profundización filosófica, ante el caos abismal de autodestrucción de los seres humanos, implica ir más allá, desplazarse de la tradición filosófica dominante para plantear una apuesta trágica: la apuesta trágica de la civilidad. Propone el proceso de creación política de civilidad, de contra-violencia, de re-civilización para contener la des-civilización (Bozarslan 2019).
Resumamos las líneas directrices de un ensayo fundamental de Balibar (2010) que lo lleva a pensar juntos violencia y civilidad. Cabe señalar que él aborda la cuestión de la violencia extrema en los acontecimientos de un nuevo tipo de guerra (las enseñanzas que saca Clausewitz de las guerras napoleónicas incontrolables e imprevisibles), y en los nuevos modos de apropiación del valor, de explotación, de sobreexplotación del trabajo y también de producción de humanos superfluos (Caloz-Tschopp 2000), aquellos y aquellas que no son integrables en la reorganización globalizada del mercado laboral o bien padecen formas de expulsión de las relaciones de clase, sexo, raza. En la construcción del Estado nacional social, del Estado a secas, esto refiere a los expulsados por diversas razones, atrapados en los complejos procesos de expulsión de sus condiciones materiales de vida, del ejercicio de la libertad política que se ejerce participando en los asuntos públicos, del mundo, especifica Arendt (1972).
Ante los debates sobre la cuestión social (de actualidad en Francia así como en otros países de la UE y en otros continentes), el autor preconiza la articulación entre ciudadanía social e invención de nuevos modos de ciudadanía que llama civilidad para superar las contradicciones del Estado nacional social y pensar la imprevisibilidad de la libertad y de la violencia extrema y sus incalculables consecuencias. Los dilemas, expresa, son difíciles de plantear y de poner en marcha (Balibar 2010). Los científicos nucleares ya pasaron por estos dilemas de la ciencia. ¿Será posible librarse de la violencia exterminadora?
Balibar desarrolla una filosofía que interpreta la frónesis de Aristóteles (prudencia, autolimitación), no sobre la base de la distinción cantidad/calidad, o en filosofía de los grados, de los límites (soportables), para calificar, clasificar los crímenes como la tortura, sino desarrollando una filosofía de los umbrales, situada en la dialéctica posible/imposible, transformada en la trágica apuesta de la acción humana colectiva e individual. De tal forma pasamos de una metafísica determinista de lo limitado/ilimitado a una filosofía política. Una antropología de la potencia/impotencia, de lo humano posible/imposible, solo en el marco humano. Este enfoque de la responsabilidad se abre a lo transindividual (Balibar 2018) y a lo transpolítico, rechazando una filosofía catastrofista sin negar la cuota de violencia en la acción humana y en las sociedades. Punto fundamental. Balibar afirma en su ensayo que la violencia se ha convertido en una aporía cuando pone en tela de juicio la posibilidad de la política y de la filosofía (Balibar 2010). Ahí se encuentra el límite infranqueable de la nada. No nos libramos de la violencia. Entonces, ¿cómo pensar en los extremos? Es una apuesta trágica por una política de anti-violencia. Es la trágica apuesta de la alteridad contra la tentación de lo absoluto, de ir hasta el final, la apuesta contra el abismo al que nos empuja la extrema violencia cuando la sufrimos, y de la cual deseamos protegernos dejándonos atrapar.
6 Desplazamiento, horizontes, vértigo
6.1 La libertad política de moverse
La huida de los migrantes ante la violencia que destruye sus condiciones materiales de vida y sus horizontes, la resistencia de los activistas solidarios, su deseo de libertad política abren el incierto horizonte, habilitando a desplazar la relación entre tortura y migración y a explorar herramientas de lucha contra la tortura. En otras palabras, pensar la relación entre tortura y migración incluye las luchas de denuncia, contra la penalización, y la creación de espacios donde reine la libertad política de moverse, lo que Arendt llama la libertad de ser libre.
Abordar el trágico desafío de la civilidad proponiendo la libertad política de moverse, interpelando lo que llamo el vértigo democrático (Caloz-Tschopp 2019), no resuelve la aporía de la violencia extrema, pero la explora incansablemente desde el deseo de libertad política, pensando en los extremos, con los medios y herramientas de que disponemos para captar y reapropiarnos incansablemente del poder democrático, y más allá de ellos. En el terreno de las relaciones entre tortura y migración, esto implica evitar caer en la trampa de las ideologías ‘populistas nacionalistas’, del mercado de lo humanitario y del mercado capitalista, para poder, al desplazarse, reapropiarse de la filosofía y la política y re-pensar la relación guerra-tierra-trabajo-capital, las regulaciones/desregulaciones del mercado de trabajo basado en la violencia política, y la falta de políticas migratorias, dominadas por el caos utilitarista.
Este desplazamiento implica establecer una distinción crítica entre la libertad de circulación de los capitales, los bienes y la mano de obra, establecida en los textos de la UE y de Schengen, la movilidad yla libertad política de moverse. En los actuales debates sobre las políticas migratorias (Pacto migratorio, leyes) la movilidad se presenta como un concepto alternativo ante la violencia económica y policial que tiende, sin éxito, a inmovilizar, a sobreexplotar, a hundir a los pueblos en la nada de la desaparición. Cabe preguntarse hasta qué punto el concepto de movilidad puede responder al imperativo de circulación globalizada del valor producido por la fuerza de trabajo del capitalismo avanzado. ¿Será suficiente la movilidad de los trabajadores migrantes para lograrlo?
Notemos que el concepto de movilidad, actualmente en debate en torno al pacto migratorio (Carlier, Crépeau 2017) y a la política europea de migración, pasa por alto la globalización de la migración y sus exigencias, y la aporía de las fronteras impuestas por el apartheid y el Estado-nación territorial y soberano. Recordemos que en la Declaración de Derechos Humanos (art. 13.2) toda persona tiene derecho a dejar su país, pero no a entrar en otro. En su película El paso suspendido de la cigüeña, Angelopoulos muestra lo que pasa en las fronteras, en las zonas de tránsito, frente a los muros, a los alambres de púas. ¡Actualmente la cigüeña, lejos de suspender su vuelo, con fronteras patrulladas, choca contra los alambres de púas, ya no puede volar ni ejercer su libertad política de moverse! Así, los derechos humanos se ven sometidos al principio de soberanía nacional de los Estados, al apartheid, a la violencia extrema.
El intento de incluir el concepto de movilidad en el corpus de los derechos humanos es sin dudas un paso notable para superar la ideología de la fuerza securitaria, nacional, identitaria, de clasificación inclusiva/expulsiva/descartable. Pero pasa por alto un desplazamiento radical necesario. Ya Arendt había subrayado la importancia de distinguir la libertad de circulación (concepto económico, utilitarista) de la libertad de movimiento para que pueda emerger la libertad política.
En resumen, al tropezar con la violencia de extremos imprevisibles y sus formas en la tortura constitutiva de las políticas migratorias, al recorrer la brecha abierta por Arendt, mi perspectiva cambió radicalmente pasando a considerar la libertad política de moverse como el eje filosófico central para pensar la vida humana y la migración, reformulando las relaciones de migración a través del desexilio del exilio. Las condiciones materiales de vida de los migrantes nos muestran la urgencia de reconsiderar con nuevos ojos a todos los seres humanos del planeta. Con espíritu creativo y horizontes ampliados es posible re-pensar la relación entre tortura y migración. No es de movilidad que tenemos que hablar sino de libertad política de moverse, una propuesta que debería inscribirse en un nuevo enfoque de la política, de la filosofía, de la ciudadanía/civilidad. Ella afecta el cuerpo, los pies de los fugitivos que caminan, y con su cabeza piensan filosóficamente en la explotación, la destrucción, la exterminación de las que están huyendo. Metafóricamente hablando, ¡hoy todos los seres humanos están huyendo de todo tipo de torturas!
El ensayo filosófico que publiqué en 2019 (Caloz-Tschopp 2019) se basó en los saberes cosechados en un ensayo anterior: L’évidence de l’asile (Caloz-Tschopp 2016c). Este último parte de una crítica a las políticas de derecho de asilo, a la acción humanitaria, siendo su objetivo la reapropiación de « la evidencia del asilo », tesoro perdido, confiscado, base de una « filosofía dis-tópica del movimiento».
Estudiando la huida de los migrantes, el segundo ensayo aportó el descubrimiento de la libertad política de moverse, revisitando el exilio (dominación) y el desexilio (lucha creativa). Para escapar de la violencia depredadora; en él se propone una filosofía del derecho de huida, que es una nueva forma de desexilio (luchas) practicada por millones de personas en el mundo. El objetivo es salir de un capitalismo expansionista sin límites, de un pensamiento de Estado, policía, guerra, fuerza, estado de urgencia (Bigo 2019), estado de excepción, categorías territoriales, soberanía de los Estados (naciones), y buscar referencias (hospitalidad, igualdad, solidaridad, etc.), debatir con filósofos, investigadores, resistentes, e imaginar espacios de transpolíticas democráticas.
El doble planteamiento fue motivado por la negativa a entrar en el campo de la migración minado por los populistas nacionalistas, eligiendo buscar un espacio, una base filosófica en el derecho a tener derechos de Arendt, de carácter más general, inscrito en la política y la filosofía del género humano caracterizado por la relación trabajo-capital-tierra-guerra y, en el capitalismo contemporáneo, por la violencia del exilio que debe combatirse con el desexilio. La apropiación de la libertad política de moverse es el imperativo por excelencia del género humano en el siglo XXI. ¡Me lo demostró la acción de huir de los migrantes ante la tortura!
El desplazamiento que busca una alternativa es colectivo. Y pervive. Trabajos que cuestionan radicalmente la fractura entre el género humano y la naturaleza aportan un nuevo enfoque a la filosofía del trabajo, de la migración, del exilio, del desexilio, efectuando un importante desplazamiento epistemológico y de categoría. Esta alternativa lleva a reencontrarse con las preocupaciones sobre el clima y a reanudar reflexiones feministas (sobre el cuerpo).
6.2 Conclusión: vivir el vértigo democrático transpolítico
El vértigo democrático es tan embriagador como el vértigo en la montaña. Es al mismo tiempo transindividual (Balibar 2018) y transpolítico (Caloz-Tschopp 2019). Pero los riesgos son grandes. Existe una tensión entre la libertad de ser libre y la violencia autodestructiva de los seres humanos y del planeta, ambas imprevisibles. Reelaborar la relación con la violencia, con la creación democrática como una relación transindividual y transpolítica es asumir el riesgo incalculable de lo que Arendt llama la ‘libertad de ser libre’, Castoriadis ‘la autonomía’ (auto-nomos, darse normas a uno mismo), Balibar ‘la apuesta trágica’. Vivir demanda curiosidad, valor, imaginación para luchar por la plena participación activa de cada ser humano en su propia vida y en los asuntos públicos en un planeta finito. Nadie puede decidir por otro su deseo de libertad política. Esto es la base, el arte del derecho a tener derechos (Caloz-Tschopp 2000) y el arte político de huir de todas las formas nihilistas de apartheid, de tortura, de destrucción, de muerte.
Los migrantes ilustran el paso de la esencia y la naturalización al vínculo con el otro fuera y dentro de uno mismo. La relación entre tortura y migración evoca el ruido de la violencia política llevada al extremo, el terror, la locura que señala Toni Morrison en el rechazo del otro, de los terceros, en el desprecio, la explotación, la destrucción cuyo único horizonte imaginable serían las políticas de desaparición. Angustia ante la brutalidad inaudita, la destrucción. Basta con escuchar a las mujeres migrantes, las historias de los africanos en Europa, de los latinoamericanos que cavan túneles bajo el muro de Trump. Noche. Ningún sueño. Pesadillas.
En su vida, Borges (1965), que era ciego, pasea a tientas « por el jardín de los senderos que se bifurcan ». Manifiestamente, en la historia, esas bifurcaciones han sido infinitas. Castoriadis explora las encrucijadas del laberinto (1975) del pensamiento para develar el poder de la imaginación y de la creación humana. Para identificar las circunstancias materiales del sometimiento, Mathieu (1991) distingue entre ceder y consentir, analizando las estrategias de libertad política de las mujeres y de las minorías. Balibar (2010) convoca a pensar en los extremos, a hacer una apuesta trágica y practicar la civilidad. Encrucijadas de descubrimientos, debates, conflictos. Ellos nos enseñan a pensar en los extremos, con los medios que hemos heredado y más allá de ellos. A vivir lo que puede llamarse el vértigo democrático hasta en sus últimos deseos, defensas, pensamientos, fragilidades, imprevisibilidad (Caloz-Tschopp 2019, 497-523).
Pensar en los extremos, pensar la tortura, la migración, con los medios heredados y más allá de ellos, es tener la audacia de desplazar el peso de los sistemas, conceptos, categorías, prejuicios, formas de gobierno autoritarias y saqueadoras, inventar un enfoque filosófico para ponerlos en tela de juicio, ponerlos en movimiento. Spinoza, Deleuze abrieron el camino.
En pocas palabras, es reconocer la dificultad para imaginar, ver, percibir. Es pensar, comprender el riesgo que implica el deseo revolucionario de libertad política y la violencia más allá de toda medida (Amati Sas 2014), su incalculabilidad, imprevisibilidad y la posibilidad/imposibilidad de contener su movimiento creador y destructor mediante la acción política de creación auto-organizada de espacios en movimiento, de civilidad solidaria en las fronteras del entorno del cual forma parte la migración. Los conceptos inmutables y estereotipados respecto a la ilusoria soberanía vertical del Estado nacional (¡ignorancia de los pueblos!) sobre el suelo, los seres humanos, las armas, los bienes, la servidumbre, el saqueo legitimado, ocultan el poder de muerte masiva y de destrucción, eluden la libertad y la responsabilidad políticas. Cuando la violencia aniquiladora se convierte en la regla de juego mundial, la autonomía, la libertad política, la responsabilidad son transpolíticas, son una apuesta trágica.
Por otra parte, pasar, sin distancia crítica, de los discursos sobre la libre-circulación de capitales, de bienes, de la fuerza laboral, a discursos sobre la movilidad no basta para contener la violencia de la apropiación del valor del trabajo, de la sobreexplotación y de la destrucción depredadora. Ser móvil es la regla del capitalismo acorralado. ¡Pero ser móvil no es forzosamente ser libre! Abrir el horizonte es imaginar que la libertad política de moverse con el cuerpo, la cabeza, los pies es constitutiva de la condición humana, de la invención de la política, de la civilidad. Ella contiene la violencia. Es la lucha por excelencia para prevenir la tortura. Desde luego, el Pacto sobre la migración, la denuncia, la sanción de los actos de tortura son necesarios. Pero además se están llevando a cabo luchas heterogéneas (por ejemplo la lucha contra las multinacionales) para salir del capitalismo, por el derecho al trabajo para todos, por verdaderas políticas de migración, por el derecho de asilo, para que se incluya en las constituciones la hospitalidad, la igualibertad, la solidaridad, el intercambio creado en las prácticas democráticas insurreccionales.
Detectar una aporía del capitalismo permitió ampliar el horizonte para pensar en las incógnitas de la relación entre tortura y migración, y recuperar la libertad política de moverse. No menciono en este artículo las múltiples medidas, los dispositivos, las herramientas que existen pero que no son escogidos ni se aplican (Caloz-Tschopp 2016c). El debate está saturado. Inercia. Falta de voluntad política, de valentía, de imaginación. Las filosofías de la ‘patata caliente’ son características de la violencia de Estado. Son una grave irresponsabilidad corta de miras.
Recordemos que la política necesita un marco auto-organizado, es lo que nos enseñan las experiencias de creación democrática horizontal, por ejemplo en las ciudades del Kurdistán, las numerosas experiencias de auto-organización, las universidades libres, y también los failed States, las guerras en la ex-Yugoeslavia, en Liberia, en las zonas de guerrilla en Colombia, las metrópolis atrapadas entre la basura, la contaminación y las drogas, las políticas de seguridad de los campos de internamiento, las cárceles, etc. Fulgores en el horizonte e infierno de Dante. Cuán difícil es hablar de avances invisibles en las luchas y también repensar el Estado vertical heredado, no ser seducido por la espiral de fuerza autoritaria y securitaria, ni por la tentación de devolver violencia por violencia en lugar de emplear la astucia para esquivarla, para huir de ella.
Querer remplazar a las víctimas por combatientes, la desobediencia civil por la guerra cívica, o ante la violencia extrema pensar en términos de autodefensa no sería suficiente para crear una política positiva de ciudadanía-civilidad, de la antiviolencia de la cual habla Balibar que implica la iniciativa de un comienzo, el otro, la alteridad, el conflicto, la disputa, el debate, que se ven en la apertura de espacios en movimiento en las fronteras, en los refugios, los Tribunales de opinión, en el proyecto de una Corte Internacional de Justicia, por ejemplo.
Pensar en los extremos, con los medios que tenemos y más allá de ellos, es reapropiarse de la libertad política sobre la cual se basa la invención democrática (imaginario, proyecto, dificultades, incógnitas). El vértigo democrático no se limita a la democracia representativa, ni a la democracia semi-directa (que conocemos en Suiza). Es un movimiento de autonomía frágil e incierto, incesantemente recomenzado, incluso ante la lógica de la tortura en todas sus formas. Después de Platón, uno de los argumentos que se esgrime a menudo contra la democracia es el riesgo de derivas. Spinoza lo retomó bajo la forma de «temor a las masas» (pero esto sería otro debate).
Me gustaría insistir aquí sobre otro riesgo positivo que se debe tomar, el de la libertad política en un tiempo de violencia extrema, el arte de esquivar la destrucción, de huir, de emplear la astucia, trabajando sobre las ambigüedades, desarrollando la doble capacidad dialéctica de desplazamiento, rodeo, aplazamiento : tener el valor lúcido de permanecer, de mantenerse firme, de sostener una posición en defensa del derecho de tener derechos en un contexto de tortura, de desapariciones, sin caer en un radicalismo abstracto, absoluto, que implica un corrimiento en el uso de la violencia incontrolable y convertirse en prisionero de efectos boomerang destructivos (Luxemburgo) y de daños colaterales incalculables.
Pensar en los extremos, con los medios existentes y más allá de ellos, es hacer la trágica apuesta de lo posible/imposible, saber que nunca nada es definitivo, que existen márgenes de maniobra de libertad, de autonomía. Las evaluaciones de conceptos relacionados con el actuar (por ej. imaginación, autonomía, servidumbre, desobediencia cívica, responsabilidad), la creación de herramientas en las luchas, van mucho más allá de lo que describen las teorías de Hobbes sobre el Estado y la violencia soberana. Kafka nos dice que podemos imaginar, pensar en esos lugares donde el humor creativo se codea con lo absurdo de la fuerza apisonadora.
Vivir la tortura en la migración, comprenderla, luchar para contenerla es un largo aprendizaje frágil e incierto de desplazamiento, en búsqueda de un nuevo paradigma político del entorno del cual forma parte la migración en movimiento. Elaborar la complejidad, la imprevisibilidad de la violencia y de la libertad, la autonomía, sin negar la trágica violencia destructora. La libertad política de moverse tiene un precio, lo que Arendt llamó «la libertad de ser libre», Castoriadis « la autonomía » y Marx «el trabajo vivo».
Bibliografía
Amati Sas, Silvia (1984). « Mégamorts, unité de mesure ou métaphore ?». Bulletin de la revue suisse de psychanalyse, 18, 11-19.
Amati Sas, Silvia (2004). « Traumatic Social Violence: Challenging our Unconscious Adaptation ». International Forum of Psychoanalysis, 13, 51-9.
Amati Sas, Silvia (2016). « Violence sociale extrême : les deux fronts de la survivance psychique ». Amati Sas, Silvia et al. (dirs.), Trois concepts pour comprendre José Bleger. Paris : L’Harmattan, 69-83.
Anders, Günther (2001). Et si je suis désespéré que voulez-vous que j’y fasse ? Paris : Alia.
Anders, Günther (2011). L’obsolescence de l’homme. Tome II : Sur la destruction de la vie à l’époque de la troisième révolution industrielle. Paris : Fario.
Antelme, Robert (1957). L’espèce humaine. Paris : Gallimard.
Arendt, Hannah (1966). Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal. Paris : Gallimard.
Arendt, Hannah (1972). Le système totalitaire. Paris : Points-Essai.
Arendt, Hannah (1981). La Vie de l’esprit. Paris : PUF.
Arendt, Hannah (2019). La liberté d’être libre. Paris : Payot.
Balibar, Etienne (1997). La crainte des masses. Paris: Galilée.
Balibar, Etienne (2010). Violence et civilité. Paris : Galilée.
Balibar, Etienne (2018). Spinoza politique. Le transindividuel. Paris : PUF.
Bigo, Didier (2019). « Les modalités des dispositifs d’état d’urgence ». Cultures & Conflits, 113, printemps, 7-15. URL http://journals.openedition. org/conflits/20710 (2019-11-19).
Borges, Jorge-Luis (1965). « Le jardin aux sentiers qui bifurquent ». Fictions. Paris: Folio, 91-107.
Bozarslan, Hamit (2019). Crise, violence, dé-civilisation. Paris : éd. CNRS.
Brauman, Rony (2001). Humanitaire : le dilemme. Paris : éd. Textuel.
Brauman, Rony (2018). Guerres humanitaires ? Mensonges et intox. Paris : éd. Textuel.
Brepohl, Marion (2019). « Recherche d’historiens, politique de mémoire et colonialité ». Caloz-Tschopp, Marie-Claire et al. (dirs.), Vers le desexil. Paris : L’Harmattan, 313-31.
Brown, Wendy (2009). Les murs de séparation et le déclin de la souveraineté étatique. Paris : Prairies ordinaires.
Caloz-Tschopp, Marie-Claire (2000). Les sans-Etat dans la philosophie d’Hannah Arendt. Lausanne : éd. Payot.
Caloz-Tschopp, Marie-Claire (2004a). Les étrangers aux frontières de l’Europe et le spectre des camps. Paris : La Dispute.
Caloz-Tschopp, Marie-Claire (2004b). Le devoir de fidélité à l’Etat entre servitude, liberté, (in)égalité. Paris : L’Harmattan.
Caloz-Tschopp, Marie-Claire (2006). « Clandestinité des femmes migrantes ». Colfen (dir.), Vivre clandestines. Bruxelles : Université des Femmes, 63-113.
Caloz-Tschopp, Marie-Claire (2007). « Philosophie, migration, démocratie et droits de l’homme». Caloz-Tschopp, Marie-Claire; Dasen, Pierre (dir). Mondialisation, migration et droits de l’homme. Bruxelles : Bruylant, 76-170.
Caloz-Tschopp, Marie-Claire (dir.) (2014). Ambiguïté, violence et civilité. (Re)lire aujourd’hui José Bleger (1923-1972) à Genève. Paris : L’Harmattan.
Caloz-Tschopp, Marie-Claire (2016a). « Apartheid en Europe : le défi de la citoyenneté/civilité dans un temps de guerre imprévisible ». Revue Française d’Histoire des Idées Politiques, 43(1), 231-55.
Caloz-Tschopp, Marie-Claire (2016b). Ambiguïté, violence et civilité. Paris : L’Harmattan.
Caloz-Tschopp, Marie-Claire (2016c). L’évidence de l’asile. Paris : L’Harmattan.
Caloz-Tschopp, Marie-Claire (2018). « Rosa Luxemburg : la découverte de l’effet boomerang de l’impérialisme et la liberté ». Caloz-Tschopp, Marie-Claire et al. (dirs.), Rosa Luxemburg, Antonio Gramsci actuels. Paris : Kimé, 103-39.
Caloz-Tschopp, Marie-Claire (2019). La liberté politique de se mouvoir. Paris : Kimé.
Caloz-Tschopp, Marie-Claire (2020) « Changer de logiciel civique ». Choisir, nr. de enero 2020.
Carlier, Jean-Yves ; Crépeau, François (2017). « De la ‘crise’ migratoire européenne au pacte mondial sur les migrations : exemple d’un mouvement sans droit ? ». Annuaire français de droit international, 1, 461-99. URL http://hdl.handle.net/2078.1/210014 (2019-11-19).
Castoriadis, Cornelius (1975). L’institution imaginaire de la société. Paris : Seuil.
Chamayou, Grégoire (2010). La chasse à l’homme. Paris : La Fabrique.
Chemillier-Gendreau, Monique (2019). Régression de la démocratie et déchainement de la violence. Paris: éd. Textuel.
Einstein, Albert, Russell, Bertand (1955). The Russell-Einstein Manifesto. London, 9th July.
Fiala, Pierre (2018). « La famille migr-, champ lexical, champ discursif ». Calabrese, Laura ; Veniard, Marie (dirs), Penser les mots, dire la migration. Paris : L’Harmattan, 145-52.
Héritier, Françoise (1996). De la violence. Paris : Odile Jacob.
Guillaumin, Colette (2000). L’idéologie raciste. Paris : Folio.
Insel, Ahmet (sitio web exil-ciph.com). « Violence, philosophie, politique aujourd’hui ». Repenser l’exil. URL http://exil-ciph.com/revue-en-ligne (2019-11-19).
Magnénat, Luc (2019). La crise environnementale sur le divan. Genève : éd. in Press.
Mathieu, Nicole-Claude (1991). L’anatomie politique. Paris : Côté-Femmes.
Monnier, Laurent (2004). « L’apartheid ne sera pas notre passé, il est notre avenir». Caloz-Tschopp, Marie-Claire (dir.), Le devoir de fidélité à l’Etat entre servitude, liberté, (in)égalité. Paris : l’Harmattan, 207-21.
Puget, Jeanine (dir.) (1989). Violence d’Etat et psychanalyse. Genève : Dunod.
Razac, Olivier (2008). Histoire politique du barbelé. Paris : Champs.
Rigaux, François (sitio web exil-ciph.com) «Qu’est-ce que l’action humanitaire?». Repenser l’exil. URL http://exil-ciph.com/revue-en-ligne (2019-11-19).
Sayad, Abdelmalek (sitio web exil-ciph.com). « L’asile dans l’espace Schengen : la définition de l’Autre (immigré, réfugié) comme enjeu des luttes sociales ». Repenser l’exil. URL http://exil-ciph.com/revue-en-ligne (2019-11-19).
Sayad, Abdelmalek (2013). La découverte de la sociologie en temps de guerre. Paris : Cécile Défaut.
Sorini, Françoise ; Branche, Raphaëlle (2002). « La torture aux frontières de l’humain ». Revue internationale des sciences sociales, 174, 591-600.
Sustam, Engin (2016). Art et subalternité kurde. Paris : L’Harmattan.
Tafelmacher, Christophe (2019). « Durcissement du droit, dilemmes de l’avocat ». Caloz-Tschopp, Marie-Claire (dir), Vers le desexil. Paris : L’Harmattan, 357-67.
Traverso, Enzo (1997). L’Histoire déchirée. Paris : Cerf.
Vahabi, Nader (2019). Violence d’Etat, crime d’Etat. Paris : L’Harmattan.
Veloso Bermedo, Teresa (2018). Franchir le seuil de la douleur extrême. Paris : L’Harmattan.
Vidal-Naquet, Pierre (1972). La torture dans la République (1954-1962). Paris: Ed. de Minuit.
Viñar, Marcelo (2018). Experiencias psicoanalíticas en la actualidad sociocultural. Buenos Aires : Noveduc.
Viñar, Marcelo et al. (1989). Exil et torture. Paris : Denoël.
Ulricksen, Maren (1998). « Le corps comme inscription de la violence sociale ». Caloz-Tschopp, Marie-Claire (dir.). Hannah Arendt, la banalité du mal comme mal politique. Paris : L’Harmattan, 94-8.
Agradezco el apoyo de Pauline, Graziella, Maria, Sabine, Teresa, Françoise, Silvia, Ahmet, Marcelo, Salomé, Steph.
[1] Por más información, véase Droit de rester pour tou.te.s, http://droit-de-rester.blogspot.com /(2019-11-19) .
[2] De ahora en adelante, con la expresión violencia extrema me estaré refiriendo a las investigaciones realizadas por Balibar sobre el tema.
[3] La guerra contra los migrantes que huyen de su tierra se está estructurando. De aquí a 2027, el personal de Frontex pasará de 700 a 10.000 funcionarios, véase
https ://www.sosf.ch/cms/upload/pdf/ SOSF-BULLETIN_3-2019_FR_DEF_A4.pdf (2019-11-19).
[4] Desde la perspectiva de un trabajo de memoria, esas políticas pueden ayudar a repensarlas a la luz de la actualidad de la tortura.
[5] En otro texto, publicado en 2020 en la revista Choisir de Ginebra, abordo otras aporías que constituyen un sistema con la aporía trabajada en este artículo (Caloz-Tschopp, 2020).
[6] Desplazamiento de las nociones de migrante, refugiado, solicitante de asilo etc. a la expresión “exiliado en desexilio”. En el marco del Programa Exilio-Desexilio del Colegio Internacional de Filosofía (véase la página web http://exil-ciph.com) y en el ensayo (Caloz-Tschopp 2019) sobre la libertad de moverse, se examina la hipótesis exploratoria de considerar el exilio y el desexilio como las actuales condiciones materiales de vida de las personas en nuestro planeta, obligadas a huir de la destrucción y a buscar medios de supervivencia.
[7] A partir de este momento utilizo la palabra Convención.
[8] Vidal-Naquet señaló que el General Massu hizo la apología de la tortura funcional comparable al acto médico de un cirujano o de un dentista. El general obvió que la tortura, lejos de limitarse a una cuestión moral, era una cuestión política en las relaciones de Francia con Argelia. Se sabe que los dispositivos y herramientas de las guerras de la colonización francesa (Vietnam, Argelia) fueron exportados, por ejemplo a las dictaduras latinoamericanas, de donde los exiliados tuvieron que huir para salvar su vida y su libertad.
[9] La historia del derecho al voto de los inmigrados es instructiva sobre el particular.
[10] Kant reflexiona sobre la paz, el derecho internacional, la propiedad común de la tierra. Este aspecto de su obra no ha sido señalado con frecuencia (Caloz-Tschopp 2019).
[11] Un hecho olvidado por la memoria pública merece ser recordado. En 1980, J.-P. Hocke, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, publicó un número especial de la revista Refugiados de la ONU sobre la creación de campos en Alemania. Ese país amenazó con cortarle los fondos al HCR si se distribuía la revista. Y la retiraron de la venta. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados dimitió de su cargo. ¡Hoy merecería una medalla de los Justos!
[12] Estados Unidos e Israel justifican la tortura por la necesidad de salvaguardar la seguridad interna del Estado.
[13] Otros ejemplos son el estatuto de las mujeres, la cuestión climática. Ya se verá en qué sentido están interrelacionados.
[14] La cuestión de los llamados ‘refugiados climáticos’ exige un cambio de paradigma para ser abordada con seriedad.
[15] El genocidio de los gitanos es casi invisible ; sin embargo, fue planificado dentro de la ‘Solución final’ nazi
[16] Le Monde, 9 de junio de 2011.
[17] El texto de Balibar ¿Qué es una frontera?, presentado al Grupo de Ginebra en 1986, le abrió las puertas a esta reflexión crítica esencial. Fue retomado por el autor en su libro El temor a las masas (Balibar 1997).