Compte-rendu, Marie-Claire Caloz-Tschopp
Tentons de rendre compte de l’apport précieux de ce livre qui est un « plaidoyer » (183) pour l’enseignement et la recherche en sociologie du travail. « Faire connaître le vécu » dans le travail en interrogeant des travailleurs « dans toutes ses dimensions est une question politique et démocratique » (183).
La question de recherche indique un souci épistémologique de l’auteur pour définir son objet, son terrain, des outils, sa méthode (p. 31-33) : partir d’une situation particulière – vente dans la grande distribution -, pour dégager un enjeu central et général : replacer au centre des débats sur le travail, la journée de travail.
Traduisons cet objet en question de philosophie politique et de citoyenneté : transformation et appropriation (vol !) du temps et donc de la vie, de l’existence des travailleuses et des travailleurs, en mettant l’accent sur les rapports de classe et de sexe.
Dans l’introduction le chercheur présente les controverses sur le temps de travail, replace la journée de travail dans l’économie politique, la situe dans les rapports de classe et de sexe, en replaçant la restructuration de la grande distribution (disponibilité temporelle, déqualification, diminution des effectifs et intensification du travail, gestion du personnel, intensification et conflits liés à la « plus-value absolue » (110), par ex.) au moment historique de l’émergence et du déclin du compromis social fordiste.
Plongeons-nous ensuite dans la démarche de recherche elle-même. Dans une première partie très riche et documentée en 6 chapitres (pp. 37-115) par des cas concrets basés sur une observation aigue et des entretiens qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs, de « gros et petits magasins », il présente la réorganisation du travail : services sous l’emprise des logiques industrielles ; flexibilité à géométrie variable ; persistance du travail taylorisé à la caisse ; restructuration permanente dans les rayons ; réduction des marges de manœuvre dans les rayons spécialisés, équipes au bord de l’explosion). Notons à propos de la flexibilité, par ex. la disponibilité notamment « d’étudiant.e.s à travailler le soir et le dimanche » (61) et le rapport finement étudié entre différents facteurs (pénibilité et clientèle, automatisation, baisse des qualifications, etc.). Le temps de travail est central dans la flexibilité, il permet de mesurer la conflictualité dans la situation actuelle (ex. conflit à propos de pauses). En fait, écrit le chercheur, ce conflit « questionne l’ensemble de l’organisation du travail » et donc les négociations devraient porter sur l’ensemble des conditions de travail, alors que les syndicats sont confinés sur certains points et ont du mal à s’imposer comme acteurs.
Dans une deuxième partie (6 chapitres, pp. 115-195), aboutissant à dégager la « norme temporelle néolibérale » (184-186), le chercheur aborde la division sociale et sexuée du travail autravers de différents axes où se dégage matériellement ce que la sociologue Guillaumin appelle « l’appropriation des femmes »[1], ici dans le travail dans les magasins : des cadres entièrement dévoués à l’entreprise ; des chef.f.es d’équipe entre le marteau et l’enclume ; des salarié.e.s sous tension permanente ; des femmes confrontées à une émancipation inachevée ; des jeunes à contre-courant ; l’indifférence à l’égard de la négociation collective. Ces points sont analysés avec des détails très concrets de l’organisation divisée du travail. Les problèmes sont multiples et hardus. La négocation collective devrait pouvoir les aborder dans leurs complexité concrète. Pour le moment, seuls les horaires d’ouverture, le temps de travail, le salaire minimum sont l’objet des négocations au niveau de l’entreprise et de la branche et les enjeux liés à l’intensification, la disponibilité temporelle et la déqualification en sont exclus, écrit-il. On mesure combien ils concernent les femmes et les jeunes.
Les syndicats ne parviennent pas à s’imposer auprès des patrons et « les entretiens laissent entendre que les travailleuses et travailleurs manifestent une indifférence généralisée par rapport à la négocation collective » (181). Le syndicat apparaît comme un « corps étranger » (181). On comprend les limites de l’approche syndicale appelée à se déplacer et à s’élargir.
Pour finir, citons le choix théorique du chercheur qui apparaissent très importants :
Il précise:
« une approche sociologique marxiste peu en vogue en dehors de quelques cénacles où se rencontrent des militant.e.s/ou des spécialistes. Mon approche n’a perdu ni sa pertinence ni son actualité. Elle m’a permis de saisir et de thématiser trois dimensions : (1) le transfert de richesse inhérent au rapport de travail salarié (le taux de plus-value indique le degré d’exploitation du travail par le capital) (2) la dynamique entre groupes sociaux dont les intérets sont antagonistes (considérés sous l’angle des rapports sociaux de classe et de sexe) (3) la prise en compte de la période historique actuelle (avec une conception considérant que les femmes et les hommes sont le moteur de l’histoire, mais dans les conditions qu’ils n’ont pas choisies. ». Les phénomènes de l’intensification, de la disponiblité temporelle et de la déqualification, sont les traits marquants de « la norme temporelle néolibérale » (183).
Le reste de la conclusion générale qui aurait sa place au début du livre quant aux choix de l’objet, au contenu, aux enjeux et non seulement aux résultats de la recherche, mérite d’être lue avec la plus grande attention : les impacts de la réduction du temps de travail ; le déclin de la norme fordiste ; la norme temporelle néolibérale (prolongement, débordement, chaos) ; un décalage entre loi, discours, pratiques ; la journée de travail va-t-elle redevenir une question sociale ? Sur ce point l’approche des rapports sociaux de sexe, montre la « consubstantialité » (classe, sexe), les mécanismes qui s’y rattachent (dont la cooptation des hommes dans les postes hiérarchiques), dont le renforcement des rapports dans la maison (travail domestique) et le décalage entre des discours sur l’égalité et les inégalités liées à la division sexuée du travail dans un secteur où les femmes sont surreprésentées. Ces questions de travail, écrit le chercheur, « sont en fait des questions politiques » (193), ce qu’une double stratégie des employeurs bien décrite suffit à montrer. Et cela dans une période où ce secteur est en difficulté (baisse de rentabilité).
« … les difficultés des travailleuses et travailleurs de la grande distribution pourraient annoncer l’émergence d’un phénomène social bien plus ample : le retour de la journée de travail au cœur de la question sociale au XXIe siècle ».
Ce qui m’amène à mon intérêt pour cette recherche de grande qualité (choix de l’objet, choix de méthode, dont la place de l’entretien des travailleuses et des travailleurs, choix théoriques et enjeux généraux qui mènent à lier ce travail à ceux d’autres domaines de ce qu’il appelle la « question sociale » (193).
Un mot sur la motivation de lecture de ce livre. En quoi les vendeuses et vendeurs de la grande distribution aurait-ils-elles quelque chose de commun avec l’exil, le desexil, les migrants et les migrantes, et plus largement avec les exilé.e.s du capitalisme contemporain pris ou expulsés du rapport Capital-Travail ?
Se poser la question implique que le cadre décrit par Marx (le Capital) et d’autres soit repris largement. Un lien étroit existe entre migration et travail, entre migrants et travailleurs, les humains ont, malgré des situations à première vue diverses, un soubassement commun qui est d’une part la domination par l’extraction de la valeur du travail… et du temps et d’autre part, l’émancipation, le socle de la construction de la solidarité au-delà des catégories de classement, des situations spécifiques, diverses, d’exploitation et de violence. L’enjeu est de taille dans une période de « grande transformation ». Le défi, face à la complexité des situations est immense. Ce livre est une pierre précieuse à l’édifice du travail de réflexion critique et de recherche.
Pour situer notre lecture de ce travail de recherche de Nicola Cianferoni, précisons notre position pour lire sa passionnante recherche, écrite dans un style limpide et sur des bases scientifiques solides.
Tout d’abord, dans nos recherches, nous travaillons sur la base d’une interrogation exploratoire pour guider la réflexion critique : dans le capitalisme contemporain, serions-nous toutes, tous des exilé.e.s et en quoi le serions-nous alors, quelles en sont les conséquences face à la globalisation (aux accords bilatéraux, à notre rapport à l’UE, aux pillages du « tiers monde »)?
Ensuite, pour pouvoir comprendre, imaginer, ne pas être piégé devant la paroi de verre de l’apartheid, ce que vivent les migrant.e.s exilé.e.s, nous postulons qu’il faut partir de la situation des femmes migrant.e.s, exil.é.e.s travailleuses, en tant que sujets de droit, citoyennes, citoyens, en sachant qu’elles constituent une grosse partie du travail clandestin hors de tout droit et de place reconnue dans la citoyenneté.
Une troisième raison nous habite. Tout humain n’est pas seulement « mobile » (le capital est mobile, mais est-il juste ? Est-il basé sur la liberté et l’égalité ?), mais doit disposer de la liberté de se mouvoir avec ses pieds, dans sa tête[2] (liberté de penser sa vie, son existence, ses droits, sa place). Précisons que nous accordons beaucoup d’importance au travail interdisciplinaire et interexpérience.
Finalement, au niveau pratique et politique, il est fondamental de construire et d’articuler le travail du mouvement social d’hospitalité, d’asile, du droit d’asile dans lequel je suis engagée, au travail des travailleuses et des travailleurs, des associations, des chercheurs qui défendent, le droit du travail, les droits des travailleuses et des travailleurs liés au « droit d’avoir des droit » de toutes et tous.
Cela est d’autant plus important que l’UDC et ceux qui assimilent l’apartheid structurel – le développement séparé, inégal permettant la surexploitation, le jetable – comme un lien social « naturel » basé sur le soi-disant droit du sol et du sang (nationalisme), vise à opposer les « nationaux » avec le passeport suisse et les « étrangers » pour cacher les rapports d’exploitation, de surexploitation, d’expulsion, de destruction (jetables, saccage de la nature). Conséquence : division des travailleurs immigrants et de la population, imposition de l’obéissance par la peur et enfouissement de la solidarité dans la haine xénophobe, classiste, raciste, sexiste. Quoi de plus normal alors que de se regarder entre humains comme des chats ennemis aux poils hérissés, plutôt que comme des égaux ?
En conclusion, bien au-delà des spécialistes du droit du travail, il est important et urgent de lire cette recherche de sociologie du travail de grande qualité et d’une grande actualité.
Marie-Claire Caloz-Tschopp, 14 février 2020.
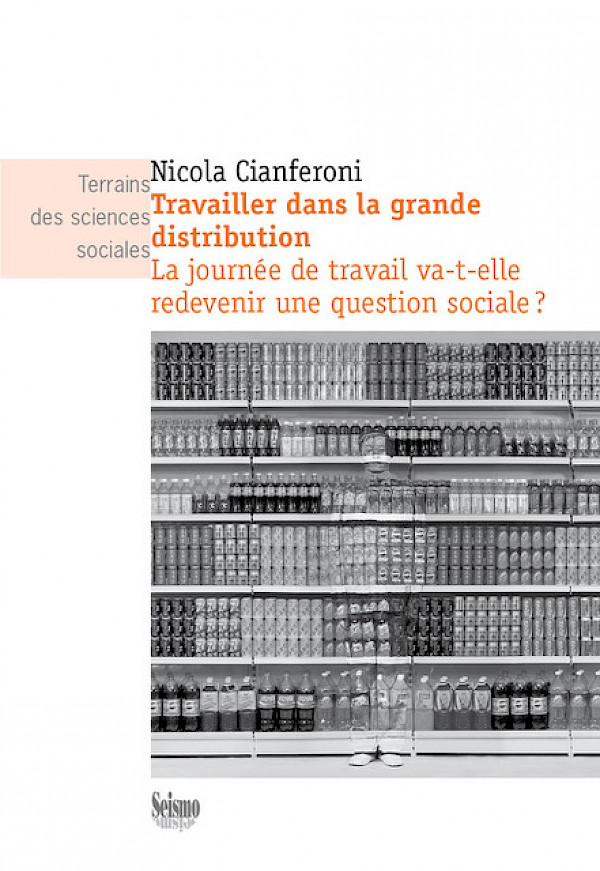
Autres travaux
Les différents travaux du chercheur se trouvent sur le site internet: https://www.nicolacianferoni.ch
[1] Guillaumin Colette, Sexe, Race et Pratique du pouvoir. L’idée de nature, Paris, Côté Femmes, 1992.
[2] Voir à ce propos un essai : Caloz-Tschopp Marie-Claire, La liberté politique de se mouvoir. La liberté politique de se mouvoir. Desexil et création : philosophie du droit de fuite, Paris, Kimé, 2019. Voir aussi le travail collectif de réflexion, recherche, formation local et transnational sur le site : exil-ciph.com